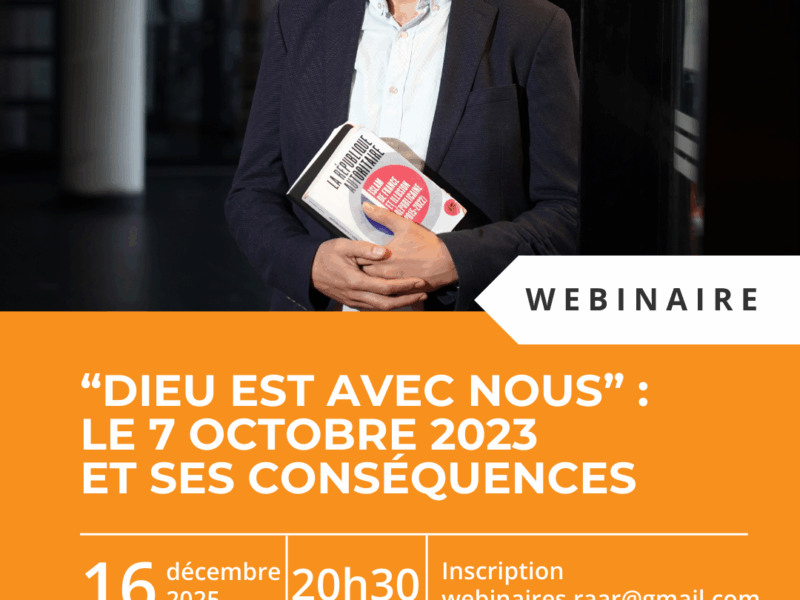Sioniste, oui, nationaliste, non
Entretien avec Martine Leibovici, in Hannah Arendt. Comprendre, Résister, Espérer, Hors-Série, Philosophie Magazine, Été 2025
Comment Hannah Arendt est-elle devenue sioniste ?
Martine Leibovici – Arendt a commencé à se rapprocher de l’organisation sioniste dans l’Allemagne des années 1930 et continuera à travailler avec des groupes sionistes, l’Aliyah des jeunes en particulier, lors de son exil parisien. Contrairement à d’autres, elle était convaincue depuis 1931 que les nazis allaient arriver au pouvoir. Dans le contexte de la montée de l’antisémitisme de ces années-là, les sionistes prennent acte de l’échec de l’assimilation, c’est-à-dire des perspectives ouvertes par l’émancipation des Juifs qui pose en principe l’égalité des droits civiques et politiques. Celle-ci se présente comme une promesse d’intégration, accueillie souvent avec enthousiasme par les Juifs eux-mêmes, d’où un assimilationisme répandu parmi eux, qui consistait à faire des efforts pour gommer toute visibilité en tant que Juifs tout en ne considérant l’antisémitisme que comme le résidu d’anciens préjugés voués à disparaître avec le progrès. Selon les sionistes, il y a là une automystification qui les empêche de prendre la mesure de la modernité politique de l’antisémitisme. Cette critique permet à Arendt de repérer une faille centrale à la problématique de l’émancipation : l’égalité étant accordée individu par individu, ce qui reste non symbolisé est le lien des Juifs entre eux, leur socialité, si ce n’est comme différence de religion. Ce lien persistait pourtant en dehors de la synagogue, mais on ne savait pas comment le nommer, ce qui lui donnait un caractère mystérieux, suscitant de la méfiance, voire de la haine. Ce qui importe pour Arendt dans le sionisme est qu’il redonne un nom à ce groupe : les Juifs sont un peuple. C’est en tant que peuple qu’ils sont visés par la « question juive » en Europe indiquée par la persistance de l’antisémitisme dans les conditions renouvelées de la modernité politique. Même lorsqu’elle aura rompu politiquement avec les sionistes, Arendt parlera toujours de « peuple Juif ». Avec eux, il était possible de dire que « lorsqu’on est attaqué en tant que Juif, c’est en tant que Juif qu’on doit se défendre ». Le sionisme a eu l’avantage de faire de la question juive une question politique. Une des grandes figures qui a compté dans sa conception du sionisme est Bernard Lazare, un écrivain et publiciste libertaire.
En quoi a-t-il inspiré Arendt ?
Martine Leibovici – Aux yeux de Lazare, il s’agissait pour les Juifs de se constituer en peuple politique, et même en nation, ce qui suppose un agir en commun, des groupes d’action. Cette idée d’agir ensemble sera au coeur de la pensée politique d’Arendt. Par ailleurs, pour Lazare, un groupe qui se constitue en peuple politique est nécessairement traversé par des divisions qu’il s’agit d’assumer. Un peuple politique est pluriel. Cela va contre le caractère fusionnel des groupes opprimés : quand on est visé par la haine ou les discriminations, on a tendance à se serrer les uns contre les autres – d’où la « chaleur », l’humanité morale des peuples parias. Un groupe ne peut s’en tenir à cette chaleur s’il aspire à une existence politique, ce qui implique d’assumer les divisions internes (à l’époque celles qu’occasionnait l’afflux des Juifs de l’est dans les pays d’Europe occidentale où résidaient des Juifs ayant acquis, depuis plus ou moins longtemps, la citoyenneté nationale). Cette approche entrait en opposition avec la conception du « peuple-un » de Herzl, dont la proposition politique n’était pas véritablement démocratique, sa pratique visant plutôt à « conduire autoritairement notre peuple en le faisait marcher comme un troupeau », écrivait Lazare. Voilà en somme comment s’élabore la conception du sionisme d’Arendt, avant ses prises de position sur la « question arabe » – selon le vocabulaire de l’époque – à partir des années 1940.
« Se constituer en peuple politique », « se constituer en nation », est-ce que ça veut dire se constituer en État ?
M.L. – L’idée qu’il fallait constituer le « foyer national » en État-nation n’était pas évidente, et les dissensions internes à ce propos étaient importantes. C’est à partir de la Conférence de Biltmore à New York, en 1942, qu’elle s’est imposée à l’ensemble du mouvement sioniste sous la houlette de Ben Gourion. Par définition l’État-nation revendique sa souveraineté sur un territoire délimité, sur lequel un peuple reconnait son unité dans une nation qui est sa source de légitimité malgré les différences et les conflits qui le travaillent. Le modèle c’est la France, et ce sont les événements récents qui, pour Arendt, ont dévoilé les impasses de son importation dans des régions où les conditions d’un peuple historiquement homogénéisé à partir de l’État ne sont pas réunies. Après la Première Guerre mondiale, les grands empires éclatent (principalement l’Autriche-Hongrie), et laissent place à des petits États nationaux (Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie, etc), qui réunissent un peuple majoritaire qui se reconnaissait en lui, et une forte minorité (près de la moitié de la population) dont les revendications stato-nationales n’étaient pas satisfaites. D’où une source permanente d’instabilité. Avec un État-nation tirant sa légitimité d’un peuple juif aspirant à la majorité par rapport à un peuple arabe palestinien devenu minorité, la même chose était à craindre à partir de la Palestine mandataire, avec en plus le risque que les membres de cette minorité deviennent des citoyens de seconde zone. Une difficulté supplémentaire en l’occurrence était que les Juifs avaient à se constituer en majorité démographique, alors qu’ à l’époque, ils étaient minoritaires en Palestine. La démographie a toujours été une grande préoccupation des sionistes. Mais résoudre ce « problème » ne changerait au fond rien pour Arendt…
Pour quelle raison ?
M.L. – Quand bien même on parviendrait à créer, en Palestine, une majorité juive importante, par l’afflux de Juifs ou par la « production d’une nouvelle catégorie de réfugiés apatrides », une réalité géographique demeurait : l’Etat juif serait entouré de pays arabes, face auxquels les Juifs seraient toujours un petit peuple. La majorité démographique ne résolvait rien si ces voisins étaient hostiles. « Un foyer national juif que le peule voisin ne reconnaît pas et ne respecte pas n’est pas un foyer, mais une illusion. » La déclaration de Balfour, secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, a été perçue, par beaucoup de Juifs, comme un miracle. Mais pour Arendt, proche en cela de Lazare, au lieu de se placer dans la dépendance d’une grande puissance, le Royaume uni à l’époque, les Juifs de Palestine auraient dû s’efforcer de tisser des liens avec les autres peuples opprimés de la région. Il y a eu quelques tentatives, mais elles ont été vite oubliées. Sur le terrain, c’est plutôt l’isolement qui s’est de plus en plus accentué. En 1948, pendant la première guerre israélo-arabe, Arendt écrit : « Même si les Juifs devaient gagner la guerre, la fin du conflit verrait la destruction des possibilités uniques du sionisme en Palestine. Le pays qui naîtrait serait quelque chose de tout à fait différent du rêve des Juifs du monde entier, sionistes et non sionistes. Les Juifs victorieux vivraient environnés par une population arabe entièrement hostile, enfermés entre des frontières constamment menacées, occupés à leur autodéfense physique au point d’y perdre tous leurs autres intérêts et toutes leurs autres activités. Le développement d’une culture juive cesserait d’être le souci du peuple entier. L’expérimentation sociale serait écartée comme un luxe inutile [Arendt pense aux kibboutzim], la pensée politique serait centrée sur la stratégie militaire. Le développement économique serait exclusivement déterminé par les besoins de la guerre. Et tout cela serait le destin d’une nation qui, quel que soit le nombre d’immigrants qu’elle absorberait, est aussi loin qu’elle étendrait cette frontière (la revendication absurde des révisionnistes inclut l’ensemble de la Palestine et la Transjordanie) resterait néanmoins un tout petit peuple, largement supplanté en nombre par des voisins hostiles. » Un tel État, conclut Arendt, « ne peut être institué qu’aux dépens du foyer national juif »
Le sionisme est-il un colonialisme pour Arendt ?
M.L. – Il y a eu, depuis 1967 en particulier, des formes claires de colonisation. En revanche, pour Arendt l’implantation des Juifs en Palestine a été tout autre chose que le colonialisme de puissances impériales qui s’appropriaient des territoires pour en exploiter les ressources « à l’aide de la main d’oeuvre autochtone et aux dépens de celle-ci » afin d’alimenter leur économie nationale. Les Juifs s’installaient là pour vivre, sans métropole d’origine, et beaucoup, notamment socialistes, ne voulaient pas faire travailler les Arabes, de peur de se comporter comme des exploiteurs. Comme souvent dans l’histoire, ce que Merleau-Ponty nomme « le maléfice de la vie à plusieurs » se retourne contre les bonnes intentions. Bien des Arabes palestiniens, sans doute, auraient voulu participer à l’élévation du niveau de vie économique dont le sionisme était porteur. Mais la doctrine du « travail juif » a conduit à l’absence de coopération économique entre Juifs et Arabes, entre travailleurs juifs et arabes. Les deux peuples ont vécu côte à côte, « dans une mutuelle indifférence au point qu’aucun intérêt commun n’était possible ». Le développement économique séparé du foyer national juif a engendré l’illusion que l’on pouvait régler « les problèmes sociaux et politiques soulevés par la présence d’une population autochtone sans prendre en compte les facteurs objectifs ». Plus généralement, un pays a besoin de partenaires locaux non seulement politiques mais aussi économiques pour prospérer en sécurité.
Quelle a été la réaction d’Arendt au moment de la création de l’État d’Israël?
M.L. – Arendt n’était pas favorable, je l’ai dit, à l’État-nation en Palestine, mais pas plus à la partition de la Palestine, en deux petits États nationaux. Jusqu’à la création de l’État d’Israël Arendt a milité pour une fédération. C’est en ce sens qu’elle comprenait la proposition d’un État binational : il aurait fallu partir de « conseils locaux judéo-arabes » et construire à partir de là, par délégation, un « gouvernement commun pour deux peuples différents » . C’était aussi la position du rabbin américain Judah Magnes. Une fois que les partisans de l’État-nation l’ont emporté, la fédération est devenue impossible, d’autant plus que ni les Juifs ni les Arabes n’en voulaient. Quelles que soient les critiques sur la manière dont l’État d’Israël est né, Arendt n’est jamais revenue sur ce fait, elle n’a jamais remis en question son existence. Arendt et Magnes ont alors plaidé jusqu’à la dernière minute pour une confédération : d’accord pour deux États, mais essayons de créer par délégation partielle de souveraineté des instances pour prendre en charge des questions communes : par exemple la question de l’eau ou les relations internationales. Le projet A Land for All reprend aujourd’hui cette idée de confédération, comme une meilleure option que la seule revendication de deux États côte à côte.
Les choses auraient pu se passer autrement ?
M.L. – Je déplore la multiplication des discours actuels qui affirment que dès Herzl, tout était déjà écrit, que ce qu’on voit à Gaza, caractérisé dès le 9 octobre par certains comme la mise en œuvre d’un génocide, est la vérité du sionisme, comme si le ver était dans fruit. C’est une conception téléologique de l’histoire que rejette totalement Arendt. L’histoire, est tissée d’une conjonction contingente d’éléments qui proviennent de problèmes politiques non résolus et qui, à un moment, se cristallisent en une situation irréversible. Mais il n’y a pas de sens de l’histoire. Le sionisme aurait pu se développer autrement. Et l’antisionisme réducteur est souvent l’alibi d’un nouvel antisémitisme. En revanche, Arendt a protesté très tôt contre les méthodes terroristes et le « chauvinisme raciste » des révisionnistes. Ce sont malheureusement les courants issus de cette mouvance qui l’emportent depuis trop longtemps en Israël. Arendt se reconnaît dans une « tradition non nationaliste du sionisme », ce qui n’est pas la même chose qu’un anti-sionisme.
Quelle lecture aurait Arendt de ce qui se passe aujourd’hui ?
M.L. – Je n’en sais rien ! Il n’y a pas d’arendtianisme à partir duquel on peut déduire des positions à propos de tout ce qui arrive. Le jugement politique d’Arendt sur les événements est toujours au présent, en prise avec la contingence de l’histoire. Il n’y a pas de kit d’interprétation arendtien. Tout ce que je pourrais vous dire, c’est comment je vois, moi, les choses en tant que familière de la pensée d’Arendt.Ses jugements sont souvent ancrés dans l’affect. L’horreur qu’ont provoqué en nous les récits des attaques du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre indique quelque chose de sa nature politique, qu’il s’agit d’élaborer. Le Hamas est un mouvement né de la situation d’un peuple opprimé qui se revendique de sa libération. Mais, d’après Arendt, même l’opprimé a une responsabilité dès lors qu’il agit politiquement : il y a des options dans le réel et dans la façon dont les actions de « libération » sont menées . Pour beaucoup la fin justifie les moyens : on condamne mollement les crimes du Hamas, tout en affirmant que sa lutte est légitime, et que celle-ci excuse au fond les pires exactions. Ce n’est pas ce que j’ai retenu d’Arendt. Beaucoup de mouvements de libération nationale ou d’émancipation des peuples se sont mués en mouvements totalitaires. C’est l’un des drames de l’histoire du XXe siècle. Ce qui est fait au moment de la résistance indique le projet qui risque d’arriver au pouvoir. A-t-on envie de vivre sous le pouvoir d’un groupe qui agit comme le Hamas ?
Et la riposte d’Israël ?
M.L. – Il faut porter un jugement aussi exigeant sur les opérations israéliennes. Il y a une guerre, mais il n’y a plus de but de guerre. Que fait ce gouvernement ? Il bombarde des populations civiles (ce qui n’est pas nouveau) mais il porte atteinte, d’une façon extrêmement grave aux conditions d’existence du peuple de Gaza : la famine, la destruction des infrastructures de santé, etc. Les Gazaouis sont constamment déplacés, bloqués, coincés le long de la mer par un cordon de sécurité, sans pouvoir fuir vers un autre pays. C’est une population qui est en train de devenir « superflue », et c’est là que réside un risque génocidaire, dès lors que ceux qui contrôlent ces êtres humains, femmes, hommes et enfants, ne savent pas quoi en faire. Je redoute que certains n’en viennent à envisager une solution plus définitive, qui est d’ailleurs clairement évoquée par des membres officiels du gouvernement, en particulier depuis la rupture de la trève en mars 2025. Arendt a ces mots qui résonnent tragiquement avec la situation actuelle : « Si les non-sionistes avaient voulu agir comme de vrais réalistes dans la politique juive, ils auraient dû insister et insister encore sur le fait que la seule réalité permanente dans toute cette constellation était la présence des Arabes en Palestine, une réalité qu’aucune décision ne pouvait modifier, excepté peut-être la décision d’un État totalitaire appliqué avec la force brutale qui lui est propre. » L’État d’Israël n’est peut-être pas un État totalitaire, mais les méthodes qu’il emploie à Gaza et qu’il laisse se produire en Cisjordanie font sérieusement penser à des méthodes de ce type.
Diriez-vous qu’Arendt a une attente particulière, envers le peuple qui a subi la Shoah ?
M.L. – Arendt n’attend pas quelque chose de plus des Juifs. Pour elle, le « comme les autres » que les Juifs doivent devenir, selon la formulation de la normalisation à laquelle les sionistes aspiraient, ne veut pas dire leur devenir identiques – aucun peuple n’est identique aux autres – mais qu’ils deviennent un peuple « parmi les autres ». Il se trouve qu’Israël, quelles que soient les critiques qu’on lui adresse, est selon Arendt, la seule instance politique issue du peuple juif comme tel. C’est pourquoi, même si elle aurait préféré qu’Eichmann soit jugé par une cour pénale internationale, elle n’a jamais dénié la légitimité du tribunal qui le condamna, et donc celle d’Israël. Le corollaire est que l’accession à une existence politique, c’est-à-dire étatique en l’occurrence, veut dire assumer la responsabilité de ce qu’on fait. Et ce que fait cet État, qui n’a jamais renoncé au nom juif, concerne les Juifs du monde entier, qu’ils soient ou non sionistes, surtout quand il agit de façon répréhensible. Comme le dit Arendt, le mal commis par mon propre peuple m’affecte plus que le mal fait par d’autres. Je pense que beaucoup de Juifs ressentent ce qui est commis aujourd’hui à Gaza et en Cisjordanie comme un déchirement.