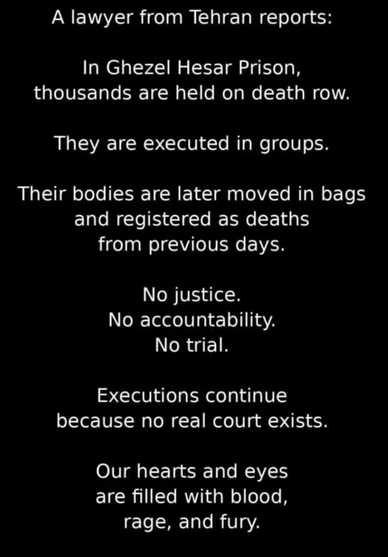Cosmopolitisme, solidarité et justice
Cosmopolis, 2025-1-2
Alain Policar, politiste, Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof)
Le cosmopolitisme est d’abord, à mes yeux, un état d’esprit, lequel doit être compris comme réaction contre le culte des origines ou la sacralisation des racines. Ce qui détermine cette réaction, c’est le lien fortuit entre ce que nous sommes et cet endroit que nous habitons, « perdu dans un canton de l’univers », comme l’écrivait Pascal. Nous avons un droit de commune possession de la surface de la terre, et personne n’a donc celui de se trouver originairement à un endroit de la terre plutôt qu’à un autre, selon la suggestive formulation de Kant.
C’est sur cette absence de droit originaire que je fonde celui de l’étranger à être un candidat virtuel à la citoyenneté. C’est donc à une conception renouvelée de la citoyenneté que je nous invite à penser. Ses fondements se situent dans l’état du monde, ou plus précisément dans les indécentes inégalités entre nations, ce qui m’incitera à penser le cosmopolitisme comme une forme contemporaine d’une théorie de la justice globale.
Une théorie de la justice globale
Je fais du souci moral à l’égard des autres une valeur en soi, et je le considère comme partie intégrante de l’obligation de mener nous-mêmes une vie bonne, idée centrale en philosophie politique (et en philosophie morale). Adam Smith, l’un des fondateurs de la théorie classique en économie et, le plus souvent, réduit à ce rôle, écrivait qu’aussi égoïste l’homme puisse être, « il y a certains principes dans sa nature qui le conduisent à s’intéresser à la fortune des autres et qui lui rendent nécessaire leur bonheur, quoi qu’il n’en retire rien d’autre que le plaisir de les voir heureux »[1]. L’attachement à une communauté politique donnée est corrélé au sentiment d’appartenir à une communauté juste. Pour le dire de façon plus concrète, nous sommes nombreux à préférer la France des droits de l’homme à celle de l’Empire colonial.
Dette et solidarité
C’est d’ailleurs dans la philosophie des droits de l’homme que se fonde, chez Léon Bourgeois, l’idée de solidarité-devoir, laquelle exige la justice : « Nous poursuivons une autre fin que celle de la nature, nous devons intervenir pour modifier ses résultats, nous devons substituer au fait naturel de l’iniquité le fait social de la justice »[2]. D’où la nécessité d’une organisation qui mutualiserait les avantages et les risques de la solidarité naturelle. Les hommes sont liés les uns aux autres par des devoirs stricts et non plus seulement par des relations de bonté ou de charité. Aussi nous faut-il rendre à la collectivité l’équivalent de ce que nous avons reçu d’elle. Autrement dit, nous naissons avec une dette sociale dont il appartient à la société de régler la valeur et le mode d’acquittement.
Il convient de remarquer que cette notion de dette sociale, si elle est vulgarisée par Bourgeois, se trouve déjà chez Auguste Comte. L’idée d’une contribution du passé, qui « nous pénètre, nous soutient, nous constitue et nous fait vivre »[3], renvoie à la thématique comtienne de la transmission : il existe une continuité dans l’histoire humaine et, de cette continuité, naît la solidarité. Cependant, en donnant au concept de justice une place centrale, Bourgeois tire des conséquences originales du concept positiviste de continuité. Sans doute faut-il voir ici l’influence de Rousseau, particulièrement explicite dans la théorie du quasi-contrat. La communauté serait, en effet, fondée sur une sorte de contrat tacite faisant de chacun le débiteur de l’autre. Ce quasi-contrat n’a pas pour but de parvenir au nivellement absolu des conditions, impossible et, probablement, selon Bourgeois, non souhaitable, mais « de faire disparaître, pour réaliser la justice, les inégalités de condition qui sont le fait des hommes eux-mêmes, de leur ignorance, de leur égoïsme, de leur âpreté au gain, de leur violence »[4].
Cette idée de la dette trouve, dans la pensée d’Achille Mbembe, une expression contemporaine : « Ce sont d’autres que nous qui, toujours, nous ouvrent à la vie. Nous ne leur devons pas seulement notre naissance, mais aussi la langue, les institutions fondamentales, divers héritages et richesses immatérielles, à la fois incalculables et non remboursables, dont nous ne sommes pas les auteurs premiers. Cette forme originaire de la dette nous place dans l’obligation de léguer à ceux et celles qui viennent après nous un monde autrement possible »[5]. Dès lors, j’interprète cette dette comme exprimant l’impératif moral et politique de la solidarité internationale, autrement dit du devoir de porter assistance à tous ceux qui souffrent, sans considération de nationalité ou d’origine. Je rejette donc la thèse selon laquelle les frontières étatiques justifient une restriction de l’étendue des obligations de justice aux seuls territoires délimités par les États.
Le rejet de cette limitation est fondé sur un principe, très généralement partagé par les auteurs favorables au cosmopolitisme, celui de l’individualisme éthique, selon lequel les êtres humains individuels sont les unités ultimes de nos préoccupations morales, sans égard au groupe auquel ils appartiennent. On parle parfois de cosmopolitisme radical pour désigner l’idée que seuls les individus, et non les nations ou les cultures, se voient attribuer une valeur morale intrinsèque. Et, en effet, le droit cosmopolitique doit avant tout protéger l’intégrité des sujets de droit individuels contre les abus éventuels des Etats-nations. La priorité accordée à la dignité individuelle ne signifie pas négliger l’importance des familles, des communautés et des pays, mais seulement tenir leur valeur pour dérivative[6].
Dès lors, l’autonomie, c’est-à-dire la possibilité pour les individus de s’autodéterminer, de former et de réviser leurs fins et leurs conceptions du bien et du bonheur, représente une valeur centrale qu’il faut promouvoir partout à travers le monde, notamment en assurant ses conditions matérielles, ce qui implique certaines mesures de justice distributive globale. De ce point de vue, il serait contradictoire de ne pas vouloir poursuivre à l’échelle internationale les idéaux moraux égalitaires et les principes de justice valables à l’échelle nationale.
Les circonstances de la justice
Elles font référence à l’idée, que l’on doit à David Hume, selon laquelle le fait d’être engagé dans des activités avec ceux avec lesquels nous partageons le monde appelle des considérations de justice. Notre engagement dans ces activités présuppose trois choses, la pluralité, la connexion et la finitude : il y a des autres auxquels nous sommes connectés, et ces autres ont des capacités limitées. Or nous savons bien que les conflits à propos de la distribution des biens transcendent les frontières. Il s’agit dès lors de décrire les circonstances, essentiellement l’augmentation du volume des transactions commerciales et l’existence d’institutions qui influencent la distribution des richesses, qui rendent nécessaire une justice distributive globale.
Si l’on admet que les institutions déterminent largement nos chances de réussite (ne serait-ce que parce que les inégalités produisent des structures de pouvoir dont l’influence sur le cours de nos vies est peu discutable), il relève de notre responsabilité de lutter contre des avantages moralement arbitraires, c’est-à-dire qui relèvent des circonstances et non des choix. Or, de nombreuses institutions internationales, notamment celles qui visent à libéraliser le commerce ou à garantir la stabilité financière, sont impliquées, en disposant d’instruments contraignants, dans la distribution de richesses. L’influence qu’elles exercent sur les politiques économiques nationales n’est plus à démontrer, tout particulièrement par l’exigence de limitation des dépenses, laquelle entraîne d’importantes coupes dans les services publics.
La globalisation, définie comme le phénomène d’extension du néo-libéralisme, au fur et à mesure qu’elle efface les frontières, afin de permettre une meilleure circulation des capitaux, construit des murs pour empêcher celle des personnes[7]. En tant que processus de réorganisation spatiale et temporelle des rapports humains, elle affecte nécessairement la répartition des richesses, d’autant que l’existence d’un marché global limite considérablement les possibilités de l’État-nation de redistribuer les richesses à sa guise. Tout (soit les intérêts des entreprises privées) concourt à pousser les salaires à la baisse et à laminer le système de protection sociale. Or les effets de la globalisation, dont on perçoit les conséquences dans les pays riches, n’épargnent pas les nations sous-développées, contraintes de parier sur leurs « avantages comparatifs », soit une main d’œuvre bon marché, faiblement protégée sur le marché du travail.
Il peut être heuristique de la distinguer de la mondialisation, que l’on caractériserait par quatre traits principaux : une augmentation de l’extension des réseaux d’activités sociales, politiques et économiques au-delà des frontières, un accroissement de l’intensité des interconnexions, une augmentation de la vélocité des processus d’interaction, un approfondissement de l’impact des événements distants. Dans cette perspective, le concept de mondialisation n’est pas nécessairement doté d’une valeur négative, puisque, entendu dans son sens strictement politique, il se préoccuperait des pratiques partagées susceptibles de faire monde.
On a souvent souligné l’insuffisance de la force coercitive de cette structure globale, au regard du pouvoir d’un État souverain, lequel seul disposerait d’une signification morale l’autorisant, pour faire appliquer la loi, à violer l’autonomie des citoyens. Or s’il importe en effet de justifier moralement ce qui met en cause l’autonomie individuelle, cette justification exige une théorie de la justice distributive globale. Celle-ci « suppose de considérer que le monde est une échelle à laquelle on peut penser une action politique, qu’il y a des problèmes propres à cette échelle et donc que la politique doit s’y hisser, ce qui est une prétention explicitement cosmopolitique »[8]. Il existe des biens, qui doivent être considérés comme des biens publics mondiaux, dont les avantages ne sont pas limités à un seul pays (la santé, l’éducation, l’environnement, la paix). L’extrême pauvreté est, nous l’avons vu, une réalité proprement cosmopolitique. De nature autonome (elle n’est pas la somme des pauvretés nationales), elle souligne l’incapacité de la citoyenneté nationale à résoudre certains problèmes globaux.
Une conception renouvelée de la citoyenneté
On voit que le cosmopolitisme ne peut se contenter d’être moral. Il nécessite une autre conception de la citoyenneté. Je voudrais donc dégager ce que l’on peut nommer la vocation critique de la citoyenneté universelle, citoyenneté universelle dont je vais essayer de dessiner les contours.
Le droit d’avoir des droits
Je me situe dans une filiation, celle des stoïciens, pour laquelle la citoyenneté native est un événement purement conjoncturel. Il n’y a donc pas pour ces philosophes d’opposition entre citoyenneté nationale et citoyenneté universelle, la seconde étant le moyen d’améliorer les modalités de la première, et non son substitut.
A ce point de mon exposé, je voudrais faire part d’une difficulté de taille : on peut la présenter sous forme d’un conflit. Conflit entre, d’une part, le principe d’universalité des droits humains, lequel, par définition, s’applique quelle que soit la nationalité des individus, et, d’autre part, l’exclusivité des devoirs politiques liant les concitoyens entre eux. La citoyenneté est en effet un principe d’exclusion puisqu’elle accepte une différence de traitement politique entre nationaux et étrangers. Or ce principe conteste l’idée d’une égalité morale de chaque individu et semble donc constituer les fondements d’une impossibilité théorique du cosmopolitisme. Le rapport de la citoyenneté à l’exclusion de l’étranger apparaît ainsi comme un problème central dès que l’on vise un horizon cosmopolitique. D’où l’importance de défendre une conception de la citoyenneté alternative.
Pour aider à penser ce rapport, on peut se référer à une notion forgée par Hannah Arendt dans le contexte de l’analyse du totalitarisme : le « droit d’avoir des droits ». Si les droits de l’homme relèvent bien d’une citoyenneté, ce n’est pas celle de l’État-nation, mais celle d’un statut politique en construction, indépendant des frontières. Pour permettre la pleine effectivité des droits de l’homme, que garantit l’article 28 de la Déclaration universelle, il est donc nécessaire de les ancrer dans la lutte contre les inégalités d’accès à leur exercice. En d’autres termes, il ne saurait y avoir contradiction entre l’homme et le citoyen : jamais un droit concernant la citoyenneté ne peut contredire quelque droit de l’homme que ce soit. Bref, le cosmopolitisme reconnaît à chacun des droits liés à son appartenance au monde.
Dès lors, l’exigence de citoyenneté doit tenir compte des revendications en excès par rapport aux droits formels garantis par la seule nationalité. C’est donc en tant que « travailleurs », défenseurs des droits de l’homme, écologistes, etc. que des individus formulent des exigences juridiques indépendantes de leur appartenance nationale. Ces exigences produisent de nouvelles normes opposables aux États, aux groupes ou aux individus dont les activités y dérogeraient. Au fond, l’exigence de citoyenneté naît bien souvent du refus d’une condition sociale devenue intolérable.
On dira que le « droit cosmopolitique » au sens strict concerne les prétentions juridiques que les « étrangers » peuvent faire valoir face aux États. Le cosmopolitisme est par conséquent rigoureusement incompatible avec l’homogénéisation produite par la globalisation néo-libérale. Il est, au contraire, un moyen de lutter contre la domination que cette dernière induit, ce qui implique de réviser le statut et la signification de la frontière.
Certains acteurs de la vie politique revendiquent une « fraternité sans frontières ». On a beau jeu de leur rappeler le « poids du réel » et de les renvoyer à leur utopisme. C’est sans doute confondre utopie, en tant que création politique, et chimère. Il serait chimérique d’imaginer que l’on puisse rester un partisan de la démocratie sans prendre au sérieux la réalité des inégalités devant l’accès aux droits créées par la globalisation néolibérale.
En outre, parler de « fraternité sans frontières », cela signifie-t-il vouloir abolir les frontières ? Certes, si celles-ci sont considérées pour ce qu’elles sont vraiment, à savoir « une limite géographique et politique, un trait qui distingue un ici et un là », elles perdent toute valeur morale. Mais cette contingence n’est pas, à mon sens, le dernier mot de l’affaire. En fait, les frontières reçoivent une légitimation rétroactive, dans la mesure où les pratiques démocratiques constituent progressivement une communauté politique à laquelle on accorde généralement une valeur morale (même lorsqu’elle est le résultat d’une histoire injuste).
Mais la question essentielle reste posée : de cette communauté est-il acceptable d’exclure les non-citoyens concernés, migrants ou demandeurs d’asile, lesquels sont évidemment affectés par les choix et les actions des citoyens ? Nous ne pouvons répondre à cette question en oubliant que le monde « est né des migrations, des exils et des transgressions qui ont donné naissance aux pays, aux frontières, et aux peuples qui les habitent »[9]. Je dirai donc que le point de vue cosmopolitique correspond à une ouverture de la frontière politique. Il se conjugue ainsi avec la nécessité d’une politique des migrations qui se départirait des seuls intérêts de l’État national.
Mais relativiser l’importance des frontières ne suppose pas souhaiter la disparition de la compétence de l’État, tout simplement parce que l‘existence de nouveaux espaces de délibération ne doit pas conduire à la disparition des espaces antérieurs.
J’ajoute, pour conclure sur ce point, que séparer, au sein d’une même société, ceux qui peuvent se prévaloir du statut de citoyen et ceux qui en sont privés revient à dénaturer le concept de citoyenneté puisqu’on légitime ainsi une différenciation des droits.
Je souhaiterais, désormais, insister sur le sens que je donne à l’idée de fraternité.
Anthropologie et politique
Une expression volontiers utilisée par Albert Cohen m’a beaucoup marqué. Il parlait de « tendresse de pitié ». C’est cette « tendresse de pitié », cette identification à l’autre, aussi vil puisse-t-il être, qui nous permet de suggérer que le fondement ultime du cosmopolitisme est l’humaine fraternité dans la mort, fraternité d’aucune patrie, d’aucune religion, d’aucune identité, fraternité sans lieu tout simplement. Et même si je ne néglige nullement l’exigence théorique, l’influence des mots d’Albert Cohen sur ma réflexion est première : « Ô vous, frères humains, vous qui pour si peu de temps remuez, immobiles bientôt et à jamais compassés et muets […], ayez pitié de vos frères en la mort, et sans plus prétendre les aimer du dérisoire amour du prochain, amour sans sérieux, amour de paroles, amour dont nous avons longuement goûté au cours des siècles et nous savons ce qu’il vaut, bornez-vous sérieux enfin, à ne plus haïr vos frères en la mort ».
La fraternité résulte aussi du fait que nous sommes essentiellement semblables. Je considère d’ailleurs notre commune nature comme, à la fois, une limite et un horizon à notre réflexion politique. En termes plus philosophiques, je pose un lien fort entre anthropologie et politique.
On a, très fréquemment, tendance à penser que l’idée de nature appliquée à l’homme constitue une profonde négation de sa liberté. Il est vrai que la délimitation d’une nature humaine a parfois servi à déterminer les individus et les groupes qui en seraient exclus. Une telle délimitation entretiendrait, dit-on, des liens profonds avec les idéologies conservatrices, réactionnaires ou racistes. Mais je doute que cette relation relève de la nécessité. La thèse inverse, celle de la malléabilité sociale absolue de l’homme, a également servi à justifier d’horribles crimes. Car si les gens sont effectivement plastiques et malléables, sans une nature psychologique propre, pourquoi ne les contrôlerait-on pas et ne les soumettrait-on pas à ceux qui disent posséder une autorité, un savoir spécialisé, nécessaires à ceux qui en manquent ?
Le choix du cosmopolitisme tient également à ce qui peut être considéré comme un propre de l’humanité, soit le fait de vivre exposés les uns aux autres, et non enfermés dans des cultures et des identités : celles-ci ne sont pas essentielles car « nous sommes tous des passants »[10].
Fragiles identités
Il s’agit de rejeter les conceptions (dites primordialistes) de l’identité collective, c’est-à-dire fondées sur la permanence de traits objectifs, invariablement une origine ethnique et une culture communes. Or, il suffit de songer à l’hétérogénéité culturelle des nations modernes pour comprendre l’impossibilité de réduire leur identité à un substrat objectif et immuable. Et, plus décisif encore, une spécificité humaine extrêmement précieuse réside dans la capacité à s’arracher au donné et à choisir d’autres appartenances que celles qui nous ont été transmises.
Accéder à la majorité
Il conviendrait donc plutôt de dire non qu’un individu appartient à une communauté, par essence ou originairement, mais de décrire la communauté comme ce qui appartient à l’individu, c’est-à-dire comme une idée ou une réalité qui ne peut avoir de sens et même d’existence que par l’acte de la choisir et de la faire sienne. Donc raisonner en termes de volonté et non d’origine. Il nous faut, en quelque sorte, imaginer d’autres appartenances[11].
Je ne parlerai pas ici de l’identité individuelle. Mais la question qui se pose pour celle-ci, à savoir quelles caractéristiques de la personne doivent être considérées comme essentielles pour qu’à travers le temps elle reste fondamentalement la même, se pose avec plus d’acuité encore pour une entité collective : comment une nation (ou une culture) peut-elle se reconnaître comme étant essentiellement ce qu’elle a toujours été ? Ces interrogations ont pour fonction d’attirer l’attention sur le flou présidant aux invocations de nos origines, de nos traditions, de nos racines.
Le raisonnement est le suivant : il nous est permis d’être de couleur noire comme d’autres sont de couleur blanche sans que ce détail nous qualifie essentiellement en tant que personne. Transformer ce caractère naturel en « négritude », ou comme on l’entend de plus en plus souvent, en blanchité ou blanchitude, et faire de celle-ci la trame même de notre existence personnelle aboutit à se dépouiller de sa singularité : « Une personne n’existe en tant que telle que si elle peut se concevoir elle-même comme distincte de toutes les marques d’identité passive ou reçue, même si, au cas où ces marques seraient celles d’hommes opprimés ou persécutés, elle les déclare siennes par esprit de solidarité »[12].
Je ne cherche pas à dire que nous devrions refuser tout sentiment d’appartenance à une nation, à une religion ou à tout autre entité collective. Mais il nous faut être capable d’imaginer, dans le temps et dans l’espace, d’autres appartenances. Cette variation, permise par l’intelligence, est le moyen d’échapper aux passions haineuses et destructrices afin « d’isoler dans son être un invariant absolu, le simple fait d’être homme »[13]. En d’autres termes, pour trouver l’universel en soi, il est nécessaire de se désencombrer de soi (et la capacité de décentrement radical fait partie de la spécificité humaine).
En utilisant le vocabulaire de Kant, on peut dire qu’accéder à la majorité c’est être devenu capable de distinguer les attributs que je reçois de mes origines de ceux dont je suis la cause. Levinas a exprimé cette idée en une formule ramassée : « Un être capable d’un autre destin que le sien est un être fécond »[14]. Pour parvenir à cet état d’esprit, nous devons opérer une réduction, c’est-à-dire une suspension du sentiment d’appartenance que nous éprouvons sans y penser envers notre nation d’origine. L’esprit est donc invité à mettre entre parenthèses nos intérêts pratiques mais aussi nos valeurs. On peut ainsi parler d’un cosmopolitisme de la raison : la raison nous fait hommes, avant que l’histoire fasse de chacun de nous, par exemple, un Français.
Pour un cosmopolitisme de l’accueil
D’ailleurs, que serait la liberté si l’on ne pouvait vraiment pas rompre avec cet accident qu’est le fait d’être né quelque part ? A l’idéal de pureté culturelle, on préférera le modèle de la contamination, lequel conduit à énoncer la règle d’or du cosmopolitisme, Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m’est étranger. Bien avant les mouvements migratoires contemporains, les stoïciens ont « contaminé les cités grecques où ils enseignaient en s’appuyant sur le savoir qu’ils avaient amené de leur pays d’origine. […] Le cosmopolitisme a été inventé par des contaminateurs qui voyageaient seuls »[15]. A la pureté culturelle, s’oppose donc un idéal, la contamination, qui fait de la liberté de choix une exigence première.
On pourrait considérer que ce plaidoyer en faveur de la mise à distance de nos appartenances, de ce que l’on nomme le désencombrement de soi reste encore, au moins en partie, dans le registre moral. Mais il n’en est rien, car la mise à distance suppose la reconnaissance. Aussi peut-on considérer les attachements singuliers comme le substrat du cosmopolitisme. Car, à partir d’eux, « les individus peuvent développer des formes de loyauté toujours plus larges, au-delà de leur communauté, de leur voisinage, ces différentes appartenances n’étant pas forcément en compétition les unes avec les autres »[16]. Les appartenances, ainsi considérées, ne renvoient pas à des lieux, au sens géographique du terme, mais ouvrent accès à l’universalité. L’accès à un monde commun présuppose donc la mise entre parenthèses des mondes particuliers (professionnel, culturel, religieux, etc.) dans lesquels nous évoluons.
Comment construire ce monde commun, autrement dit comment politiquement nous comporter vis-à-vis de l’étranger ? L’accueil des étrangers est bien un fait du monde massif, et il exemplifie la question des modalités du passage de l’indignation morale à la justice, autrement dit il dessine les contours d’un cosmopolitisme de l’accueil. Au sein de celui-ci, la figure de l’étranger est centrale. Il nous faut donc repenser la communauté du point de vue de l’accueil. Si la politique suppose vouloir créer du commun, on ne le peut précisément qu’entre étrangers, soit entre ceux qui n’ont au départ rien en commun. C’est bien l’enjeu de la politique que d’assembler ceux qui rien ne prédispose à se lier. C’est pourquoi il est fondé d’affirmer que l’hospitalité est la condition et la fin de toute politique, condition parce que « toute politique est rapport à l’étranger », et fin parce que la politique « n’a de sens que de viser la réactivation d’une hospitalité première qui seule peut prévenir la guerre de tous contre tous »[17].
C’est donc le sort réservé aux migrants qui doit avant tout être considéré. Il existe un souhait de la part de ceux-ci d’être acteurs de leur vie, autrement dit de posséder une puissance d’agir qui leur est propre. Dans le camp de migrants se présente la tâche de faire monde entre étrangers : il devient dès lors un lieu où peut se dire le politique.
[1] Adam Smith (1759), Théorie des sentiments moraux, Paris, PUF, 2003, p. 23.
[2] Léon Bourgeois, Solidarité, Paris, Armand Colin, 1897, p. 45.
[3] Léon Bourgeois, « L’idée de solidarité et ses conséquences sociales », in Léon Bourgeois et Alfred Croiset (dir.), Essai d’une philosophie de la solidarité, Paris, Alcan, 1902, p. 32.
[4] ibid., p. 80
[5] Achille Mbembe, « L’identité n’est pas essentielle », Le Monde, 26-1-2017, p. 21.
[6] C’est cette conjugaison de l’individualisme moral et de nos attachements singuliers qui, bien qu’asymétrique, justifie mon choix en faveur d’un cosmopolitisme enraciné, tel qu’il est proposé par Kwame Anthony Appiah. Voir Appiah (2006), Pour un nouveau cosmopolitisme, Paris, Odile Jacob, 2008.
[7] Voir Étienne Tassin, « La mondialisation contre la globalisation : un point de vue cosmopolitique », in Sociologie et Sociétés, vol. XLIV, n°1, printemps 2012, p. 143-166.
[8] Louis Lourme, « Le cosmopolitisme et l’exigence de justice globale », in Michaël Foessel et Louis Lourme (dir.), Cosmopolitisme et démocratie, Seuil, 2016, p. 56.
[9] Étienne Tassin, « L’Europe cosmopolitique et la citoyenneté du monde », Raison publique, no 7, octobre 2007, p. 45-63. http://www.raison-publique.fr/article229.html.
[10] A. Mbembe, art. cité, 2017.
[11] Voir Pierre Guenancia, « L’identité » in Denis Kambouchner (dir.), Notions de philosophie, II, Paris, Gallimard, 1995, p. 563-635.
[12] Ibid.
[13] Ibid., p. 621.
[14] Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, La Haye, Martinus Nijhoff, 1961, p. 258.
[15] Kwame Anthony Appiah, op. cit., 2008, p. 167.
[16] Vincenzo Cicchelli, Pluriel et commun. Sociologie d’un monde cosmopolite, Paris, Presses de Sciences Po, 2016, p. 214.
[17] Étienne Tassin, art. cité, 8-7-2017.