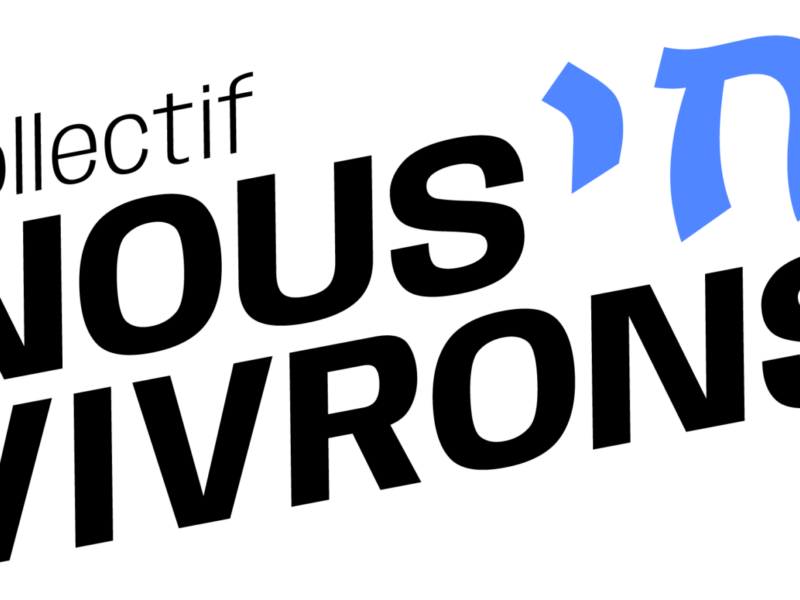« L’antisémitisme est-il un racisme ?» (Alain David), « L’antisémitisme, un racisme ? Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre » (Philippe Corcuff). Une discussion autour du « et » de « l’antisémitisme et tous les racismes »
L’antisémitisme est-il un racisme ? Alain David, philosophe, ancien directeur de programme au Ciph, membre du RAAR et de la LICRA
L’idée répandue que l’antisémitisme serait une forme de racisme me semble contre-productive. Elle expose des associations comme le RAAR ou la Licra à une objection immédiate : « mais pourquoi tenez-vous à distinguer l’antisémitisme des autres racismes, pourquoi ne pas dire simplement «Réseau d’action contre tous les racismes » ou « Ligue contre le racisme »? C’est là une position qui a été notamment celle du MRAP lorsqu’il a remplacé son intitulé « Mouvement contre l’antisémitisme, le racisme et pour la paix » par « Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples », substitution sans panache, mais qui en faisant disparaître le privilège de l’antisémitisme lui a permis de persister avec le même sigle.
J’entends bien la réponse qu’on peut formuler (et qui m’a été proposée) : oui mais justement le MRAP ne considère pas que l’antisémitisme mérite aujourd’hui un traitement à part. Or l’objectif du RAAR est de réparer ce qui semble être une erreur ou une faute, de mettre en exergue l’antisémitisme oublié par la gauche, voire d’une certaine manière instrumentalisé si ce n’est promu par une certaine gauche. Cela-même empêcherait-il de le concevoir comme étant un racisme parmi d’autres ?
Soit ! Pourtant cette réponse écarte-t-elle l’objection : pourquoi faudrait-il séparer ce racisme des autres au point d’en faire un objet central ? N’existe-t-il pas d’autres formes de racisme, qu’il serait d’autant plus nécessaire de citer qu’elles ne le sont qu’exceptionnellement – ainsi le racisme qui frappe les Rroms, ou cette autre forme de domination qui depuis des millénaires frappe les femmes et dont nos sociétés sont loin d’être quittes. Faudrait-il les délaisser au profit de l’antisémitisme ? Et pourquoi ? L’objection, nous ne le savons que trop, traverse les rangs du RAAR, créant pour certains d’entre nous un vrai malaise, une récurrente mauvaise conscience.
A cela s’ajoute un autre soupçon, inévitable et plus pernicieux : le privilège accordé à l’antisémitisme relèverait de la situation en surplomb que se seraient créée les Juifs en captant à leur profit la culpabilité occidentale, une culpabilité associée à la shoah, événement sacralisé dans lequel ils impliquent d’autres cultures, lesquelles se défendent pourtant d’avoir la moindre responsabilité dans l’extermination, et dont ils font un Universel. Avec de surcroît la «circonstance aggravante » du sionisme, forme déclarée paradigmatique dans le champ de la mondialisation et du libéralisme de l’oppression impérialiste.
Ces dérives (pour autant que ce sont des dérives) sans être générales existent, et souvent. Je tiens que le malaise, quoi qu’il en soit de sa forme, perdurera, à des degrés divers, aussi longtemps que l’on verra dans l’antisémitisme un cas d’oppression ou de violence, celui qui concerne cette population particulière que seraient les Juifs, et qui inévitablement entre en rivalité mimétique avec d’autres formes d’oppression.
La difficulté au contraire ne serait-elle pas levée si l’on faisait l’hypothèse de la singularité du phénomène de l’antisémitisme ? Quels sont les éléments plaidant pour cette hypothèse ? D’emblée cette remarque factuelle : il y a dans le monde quinze millions de personnes se réclamant, au titre de la religion, au titre d’une histoire culturelle ou familiale, ou d’une revendication identitaire, ou autrement, du judaïsme : soit moins de 0,2% de la population de la planète. Nombre infime, et sans commune mesure avec l’importance du phénomène de l’antisémitisme, sans commune mesure avec la teneur universalisante du discours antisémite (« ils sont partout… »).
Dans le même ordre d’idées alors que le racisme prend appui sur des faits présentés comme objectifs – la couleur de la peau, les caractères ethniques – l’antisémitisme se passe de tout prétexte objectif, ce qui entraîne qu’il est indéfini et de fait d’emblée sans limites. Tout être humain est pour l’antisémitisme potentiellement juif ou « enjuivé ». Le film de Losey Monsieur Klein, qu’on a pu revoir au moment de la mort d’Alain Delon me semble représenter une saisissante illustration de cette universalité paradoxale. Non réductibles à un objet déterminable, les Juifs sont pour l’antisémitisme « partout », par-delà ou plutôt en-deçà de toute identification par la religion, l’histoire ou la culture. Alors que le mot « race » enferme son objet dans des limites certes fantasmées mais déterminées, lorsqu’au XIXème siècle on applique ce mot au judaïsme il ouvre à l’imaginaire galopant des fantasmes confinés dans la rigidité des formes du racisme ordinaire. Fantasmes de la contagion et de l’impureté, de la pollution de l’espèce. Là où l’Africain ou l’Asiatique restent enkystés dans la leur et renvoyés à l’exotisme de contrées lointaines et pittoresques, devenus objets d’étude et de savoir sous le regard de l’explorateur ou de l’anthropologie raciale et proposés à la curiosité et l’avidité européennes, le Juif est d’’emblée déjà là, présent, trop présent au coeur de notre quotidien. Phusis kriptestai philei, la nature aime à se cacher disait Héraclite. La nature du Juif se cache encore davantage, il envahit subrepticement le réel et par son intelligence destructrice introduit le doute dans ce qui était certain et assuré. La rationalité, exemplairement caractérisée chez Descartes par « la clarté et la distinction », est submergée, le doute imprudemment proposé comme méthode dans l’assurance qu’il serait vaincu par l’évidence, subsiste indéfiniment, intempestivement. Témoin d’un indépassable soupçon, l’antisémitisme affecte la sérénité des formes : en en infléchissant le tracé, pressentant la courbure là où était le droit, le mou au coeur du consistant, le fuyant en place de la résolution, la féminité à même la virilité. Une sexualisation débridée s’empare ainsi d’un Réel contaminé désormais par le Juif, prenant ce réel à rebours (« enjuivé » n’est-il pas un doublet pour « enculé » et n’en détient-il pas la vérité ?), le code de l’antisémitisme, on ne le remarque peut-être pas assez se superposant régulièrement à celui de l’homophobie, se complaisant dans l’obscène, déchaînant sa violence dans sa fascination pour l’abject.
Les Juifs sont partout, affectant tous les registres de la vie, tous les noms de la langue. On connaît ces histoires juives qui portent sur « le nom juif », ce nom insistant là même où il ne devrait pas avoir lieu : M. Katzmann, qui veut franciser son nom et aboutit à Chat – Lhomme. Ou Moshe Lévy qui après avoir obtenu difficilement l’autorisation de transformer son nom en Jean Durand, refait une démarche pour devenir Bernard Dupont : « afin de pouvoir répondre quand on me demandera comment je m’appelais avant ».
Jusque dans son absence » le « nom juif » est partout présent, partout à pressentir :Amour peut-être ou de moi-même haine ?/Sa dent secrète est de moi si prochaine/Que tous les noms lui peuvent convenir !/Qu’importe ! Il voit, il veut, il songe, il touche !/Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche/A ce vivant je vis d’appartenir !
Il ne s’agit certes pas ici, dans cette strophe du « Cimetière marin » de Paul Valéry, du « nom juif ». Le poème concerne cependant, comme dans le registre de l’antisémitisme, ce qui est partout et qui contamine tout :iI voit, il veut, il songe il touche,/Ma chair lui plaît et jusque sur ma couche/A ce vivant je vis d’appartenir.
Mais Valéry parle ici de la mort, dans la mesure où la mort dans le poème est ce qui irrémédiablement hante le présent des vivants : Le vrai rongeur, le ver irréfutable/N’est point pour vous qui dormez sous la table/Il vit de vie, il ne me quitte pas !
L’inspiration du « Cimetière marin » est grecque, la mort surplombe le présent, les Grecs nommant cela « l’être », au sens où « être » veut dire aussi la possibilité de « ne pas être » : être ou ne pas être telle est la question chez les Grecs et après eux : être comme question qui affecte toutes choses, toutes les certitudes, question qui comme telle ne se ramène à rien, pesant sur ce qui est de son poids immatériel et cependant plus pesant que la matière elle-même. « Insoutenable légèreté de l’être » dit pour cela Kundera.
Et Apollinaire : Ô mon ombre ô mon vieux serpent/Au soleil parce que tu l’aimes/Je t’ai menée souviens-t’en bien/Ténébreuse épouse que j’aime/Tu es à moi en n’étant rien/Ô mon ombre en deuil de moi-même
Alors voici la question que je cherche à introduire en supposant l’antisémitisme, et avec lui la question juive, au centre : « juif », est-ce un mot qui pèse sur la vie au sens où la mort, selon la tradition la plus classique, pèse ? Dans la modalité d’une « insoutenable légèreté » ? Avec beaucoup de prescience l’antisémitisme consentirait sans doute à cela, recueillant et s’appropriant certaines métaphores, le ver, le serpent etc, en raison de ce qu’elles impliquent immédiatement de répugnant. Pourtant l’antisémitisme dans son obsession va plus loin, plus loin que n’allaient les Grecs, bien plus loin que la mort.
Plus loin que la mort ? Je voudrais tenter, sans pouvoir approfondir ici – et de manière sûrement trop allusive – un détour, qui me semble nécessaire selon ce que je cherche à exprimer : poser la question tellement sensible et difficile du génocide (et, également en sous-entendant dans ce qui suit l’hésitation entre Raphaël Lemkin et Hersch Lauterpacht, telle que la relate Philippe Sands dans son beau livre Retour à Lemberg, l’hésitation entre le génocide et le crime contre l’humanité)
Soit le livre de Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme. Elle y souligne que le Häftlinge qui a atteint le dernier degré de cachexie a cessé de relever des paramètres ordinaires qui constituent l’humanité. La mort n’est plus cette limite ultime, ce point aussi irréel que la liberté dont il est la clé, et où chaque individu, confronté au monde et à lui-même, décide en dernier ressort de ce qu’il en est de sa vie. « Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux » écrit Camus tout au début du Mythe de Sisyphe, « c’est le suicide » : n’est-ce pas, comme l’entend Camus, à cette aune du choix entre la vie et la mort que se reconnaît la liberté. Or dans le camp, remarque Arendt, il en va différemment, il n’y a paradoxalement que très peu de suicides. Car mourir est une option d’hommes libres, cette option n’existe pas dans le camp. De même que Hannah Arendt, Primo Levi y insiste : le « musulman » est la figure emblématique d’Auschwitz, s’exceptant de ce domaine où le réel s’inscrit dans la continuité de l’ensemble des possibles. « L’homme normal », écrit David Rousset à sa sortie des camps en 1946 (en une phrase que cite Arendt) « ne sait pas que tout est possible ». « Tout » c’est-à-dire en un paroxysme en rupture avec les tracés de l’être, avec l’alternative de l’être et du ne pas être, du oui et du non. etre ou ne pas être, vivre ou mourir ! (To die, to sleep – to sleep – perchance to dream, mourir, dormir – dormir – rêver peut-être dit Hamlet dans son célèbre monologue). Le choix est suspendu, telle n’est plus l’alternative pour le «musulman ».
Michel Foucault a inventé l’expression de « biopolitique » pour dire que la mort a cessé d’être ce que nous avons en propre, l’horizon indépassable de l’humain. Le philosophe italien, Giorgio Agamben, s’emparant de cette notion y associe le phénomène du camp, véritable paradigme, répondant à cette situation d’illimitation, de suspension de l’alternative être ou ne pas être. Génocide, ou crime contre l’humanité sont pensés à cette aune de l’illimité, moins des mots pour dire un nombre considérable de morts, ou le paroxysme de la cruauté, voire pour désigner ce que Raphaël Lemkin nommait le « crime des crimes » (n’est-il pas, comme y insiste Philippe Sands, de multiples autres manières de recenser les versions de l’extrême cruauté) que pour indiquer cette inscription qui signe la modernité qui advient avec le génocide ou le crime contre l’humanité, des corps désacralisés, privés de leur mort, livrés à l’illimité. La mort n’est plus la finalité, elle est indifférente, accident du « traitement » des corps (Sonderbehandlung), elle est dans le génocide et le crime contre l’humanité ce dommage collatéral lié aux contingences de la biologie, le génocide et le crime contre l’humanité engageant seulement dans leur signification biopolitique un processus de maîtrise infinie, de soumission sans limite de cela par rapport à quoi la mort n’est plus l’Evénement. Une autre anthropologie apparaît, ou (en le disant avec peut-être davantage de vérité) on est sorti de toute anthropologie : Foucault avait annoncé en une parole qui avait fait scandale (Les mots et les choses, 1966) « la mort de l’homme», il faut peut-être plus profondément entendre ici que «l’homme est mort » dans la mesure où la mort elle-même est morte, où elle ne représente plus ce surplomb par lequel l’homme comme « être à la mort » se définissait. « La liberté ou la mort ! » : ce mot d’ordre, à l’époque des génocides et des crimes contre l’humanité, est devenu juste grandiloquent.
A l’époque des génocides et des crimes contre l’humanité : «Sa dent secrète est de moi si prochaine/ Que tous les noms lui peuvent convenir. » « Le vrai rongeur, le ver irréfutable » : ces métaphores ne sauraient plus qualifier la mort.
Dès lors, à côté de « tous les noms », comme tels tous prédicables, « juif » n’est-il pas ce nom, indéfinissable et avec lequel on n’en finit pas, ce nom pour l’infini, cet indice inappropriable d’une extériorité que dans sa fureur récurrente l’antisémitisme s’emploie à masquer tout en la pressentant. « Eternellement nouveau, l’antisémitisme » dit ainsi Lénine que cite judicieusement Gérard Bensussan, laissant par là-même deviner que « la question juive » est quoi qu’il en soit, présente dans ce que la pensée de Marx a de plus profond.
Racisme et antisémitisme. Maurice Blanchot écrit « Mon idée (qu’il faut manier avec précaution) c’est que le racisme n’est qu’une forme de l’antisémitisme ». Pourquoi ? En raison de ce que l’antisémitisme indique quant à une altérité si radicale qu’elle ne se pense à partir d’aucun concept. Les sciences sociales sont hors-jeu, dit aussi Hannah Arendt en parlant de l’homme des camps: «Les chercheurs en sciences sociales qui sont des gens normaux auront beaucoup de mal à comprendre (…) que (…) les limites qu’on attribue à la psychologie humaine en général aient été abolies ou n’aient joué qu’un rôle secondaire » (Les origines du totalitarisme Gallimard, Quarto, p. 857). Ce qui conduit encore Blanchot, à poser l’antisémitisme comme « la faute capitale », expression d’une hantise s’obnubilant de l’altérité, quoi qu’il en soit de la vie et de la mort, se répétant dans ce caractère obsessionnel dans toutes les occurrences, dans tous les racismes, ceux-ci se fussent-ils affranchis de l’hypothèse ou de l’hypothèque de la race.
Mais pourquoi dès lors parler encore d’antisémitisme et de judaïsme ? Pourquoi mettre en exergue de tels particularismes s’ils doivent correspondre à une question si générale et structurelle ? L’objection revient, inévitablement, maintes fois formulée, parfois de façon sommaire et brutale, ainsi lorsque Judith Butler ou le philosophe Souleymane Bachir Diagne reprochent à Levinas d’être prisonnier d’un modèle impérialiste et raciste dans la mesure même où il veut donner au judaïsme le privilège de porter le nom et les enjeux de la question de l’altérité. Ou parfois de façon subtile et nuancée, ainsi par le philosophe Jacques Derrida, qui adresse directement cette même question à Jean-François Lyotard, mais qui par-delà un échange rapide à l’occasion d’une conférence de Lyotard, s’emploie à en déployer les éléments dans un texte d’une infinie profondeur, « La pharmacie de Platon » dans lequel il montre comment il faut reconnaître derrière la figure de Socrate emblématique de la rationalité qui traverse la culture occidentale, une autre figure, étrange, celle d’un sorcier, le « pharmakos », investi de tous les traits de l’extériorité monstrueuse incarnée par le Juif. Pourtant le pharmakos n’est pas juif, il appartient au monde grec, à la culture grecque. Et cependant, Derrida en convient, il configure depuis l’intériorité du monde grec, dans l’idiome de cette intériorité (le mot « idiome » renvoyant étymologiquement à l’intériorité) l’émergence monstrueuse – « monstrueuse » : c’est-à-dire au défaut des formes, de la forme du savoir en général – d’un dehors, d’une sortie. Ce mouvement de sortie – la fameuse « déconstruction » – pourrait-il se revendiquer d’une culture particulière dans la mesure où il objecte à toute appartenances ? Derrida le qualifie pourtant, en citant l’écrivain James Joyce (Greekjew is Jewgreek, un Juif grec est un grec juif) comme étant la façon dont le « juif », l’élément juif, s’entrelace inextricablement au grec pour y signifier une sortie des appartenances.
Cependant il y a lieu de le demander à nouveau, et inlassablement : en quoi cette « sortie » serait-elle « juive » ? La réponse est peut-être celle que Lyotard avançait d’emblée dans sa conférence, significativement intitulée « que signifie penser après Auschwitz ? » L’épreuve et le critère, pour la pensée, pour toute culture, c’est « Auschwitz », et désormais, c’est l’antisémitisme qui place le nom juif dans une situation de singularité universelle.
C’est donc à ce titre, et parce qu’il exemplifie la question de l’altérité – là-même où « juifs » et « antisémites » disparaîtraient comme tels dans l’invisibilité, une certaine invisibilité (« l’absence d’antisémitisme ne suffit nullement » a pu écrire aussi Blanchot, en une formule qui me semble d’une profondeur infinie) que je voudrais répéter que l’antisémitisme loin d’être ce racisme dont seraient victimes dans leurs caractères particuliers ces individus particuliers que sont « les juifs», est à convoquer « partout », parce que les Juifs sont partout – à convoquer partout, c’est-à-dire dans les multiples occurrences du racisme (dans « tous les racismes » ainsi que dit, si j’entends bien la formule, entre autres le RAAR) – partout : dans chaque circonstance où il y va de l’altérité.
Une discussion avec l’un d’entre nous me pousse à rappeler, en une sorte de postscriptum à ce qui précède, la dédicace (citée également par Brigitte Stora à la fin de son livre L’antisémitisme. Un meurtre intime) que Levinas avait donnée à son maître-livre Autrement qu’être :
A la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d’assassinés par les nationaux-socialistes, à côté des millions et des millions d’humains de toutes confessions et de toutes nations, victimes de la même haine de l’autre homme, du même antisémitisme
L’antisémitisme, un racisme ? Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, Philippe Corcuff, enseignant-chercheur en science politique et membre du RAAR
Dans le cadre d’échanges au sein du RAAR (Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes), mon ami le philosophe Alain David a défendu à plusieurs reprises le caractère en quelque sorte matriciel de l’antisémitisme par rapport aux différents racismes et, au-delà, vis-à-vis des diverses oppressions. Alain David s’appuie notamment sur une lettre que lui a adressée l’écrivain Maurice Blanchot, le 5 octobre 1987. Blanchot y écrit notamment : « Mon idée (qu’il faut manier avec précaution) c’est que le racisme n’est qu’une forme de l’antisémitisme ». Cela fonderait la singularité de l’antisémitisme, comme matrice du rejet radical de l’altérité.
L’exergue d’une figure de la philosophie – qui nous a tant apporté à Alain David (qui a eu la chance de le côtoyer et dont il est un fin connaisseur) et à moi (en plus modeste lecteur, OVNI levinassien en sciences sociales), Emmanuel Levinas – à un de ses ouvrages les plus importants Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1974) vient compléter l’hypothèse de l’antisémitisme comme matrice. Levinas y écrit : « A la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d’assassinés par les nationaux-socialistes, à côté des millions et des millions d’humains de toutes confessions et de toutes nations, victimes de la même haine de l’autre homme, du même antisémitisme. » « La même haine de l’autre homme, du même antisémitisme » : un autre fil quant au caractère « matriciel » de l’antisémitisme dans le rapport privilégié avec une violence radicale vis-à-vis de l’altérité. La shoah en serait à la fois la forme extrême et en même temps, sous un certain angle, la vérité : la vérité de la dynamique vers un illimité propre à la négation de ce qui fait la singularité d’autrui en tant qu’autre, et donc pas enfermable dans l’identique.
Le mot « matriciel » n’est pas le mot utilisé par Alain David pour caractériser son point de vue. C’est ma façon de l’interpréter dans un cadre plus large : celui d’une famille de positions quant à l’antisémitisme, au-delà de la singularité des analyses propres à Alain David.
Je souhaite, dans ce court texte, revenir de manière critique sur l’hypothèse « matricielle », en en envisageant les conséquences pour l’action du RAAR. Je voudrais aussi dégager de cette discussion critique et amicale, grâce à la prise en compte de la fragilité que les contextes socio-historiques font peser sur le travail de la pensée, un devoir supplémentaire d’humilité pour nos professions intellectuelles, si souvent tentées par un intellectualisme surplombant, cachant mal les fêlures de nos egos, de mon ego. Sévère avec son ami Jean-Paul Sartre et avec ses collègues, mais aussi avec lui-même, Maurice Merleau-Ponty écrit dans Les aventures de la dialectique (1955) : « Le « manque de distance » à soi, aux choses, et aux autres, est la maladie professionnelle des milieux académiques et des intellectuels. L’action n’est chez eux qu’une fuite de soi, un mode décadent de l’amour de soi. »
Ma culture de sciences sociales me pousse ainsi à ne pas oublier le poids des contextes sociaux et historiques que les débats de la philosophia perennis ont oublié. Trop souvent dans le cours des discussions philosophiques, selon un des plus grands hérétiques de l’histoire de la philosophie, Ludwig Wittgenstein : « Nous sommes sur un terrain glissant où il n’y a pas de frottement, où les conditions sont donc en un certain sens idéales, mais où, pour cette raison même, nous ne pouvons plus marcher. Mais nous voulons marcher, et nous avons besoin de frottement. » (Recherches philosophiques, 1936-1949). Et comme je veux marcher, je vais tenter de suivre l’injonction de Wittgenstein : « Revenons donc au sol raboteux ! » Cependant, je voudrais le faire en essayant de ne pas oublier la composante levinassienne de mon individualité pensante composite. Je voudrais ne pas oublier, donc, ce en quoi les altérités, toujours situées dans des contextes, tendent à déborder ces contextes, en tant qu’altérités justement. « Le visage est signification, et signification sans contexte. Je veux dire qu’autrui, dans la rectitude de son visage, n’est pas un personnage dans un contexte. […] le visage est sens à lui seul. Toi c’est toi. », dit Levinas (Éthique et infini, 1982) Le sociologue que je suis aussi dirais plus prudemment : le sens que je donne à la singularité d’autrui, quand je m’ouvre à son interpellation, tend à déborder le contexte dans laquelle elle est nécessairement saisie, parce que justement singulière. Le sol raboteux des contextes et l’échappée de l’altérité, en tension, en boîtant, de manière gauche, à gauche radicalement.
Sens et risques de l’hypothèse « matricielle »
En quel sens pourrait-on considérer l’antisémitisme comme « matriciel » par rapport à l’ensemble des racismes ? Cela ne peut pas être en un sens chronologique et historique, pour lequel l’antisémitisme ayant émergé antérieurement contiendrait, à l’état au moins potentiel, les caractéristiques à venir des racismes qui lui auraient succédé, les contiendrait au moins en puissance (selon la dichotomie entre la puissance et l’acte chez Aristote : ce qui existe en puissance, comme potentialité, pouvant être actualisé dans une action). Il y a eu dans l’histoire des sociétés humaines des racismes, avant l’invention moderne du mot « racisme », avant l’invention du judaïsme, de l’antijudaïsme chrétien et de l’antisémitisme moderne (voir le célèbre texte de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss de 1952 pour l’UNESCO, Race et Histoire).
Si ce n’est pas historique, cela pourrait être logique. Les racismes auraient comme condition de possibilité logique ce qu’on appelle aujourd’hui « antisémitisme ». Cette piste suscite plusieurs problèmes :
* Cela prétend par avance englober l’ensemble de ce qui va être lié à la condition de possibilité logique (l’antisémitisme) : tous les racismes. Cela laisse alors peu de place à la contingence historique et aux singularités des contextes dans l’appréhension des racismes. Cela tend à enfermer la pensée des racismes dans une totalité théorique peu ouverte au travail et aux hétérogénéités de l’histoire. Un des apports de l’œuvre de Levinas est sa contribution aux pensées de « la rupture de la totalité », selon ses termes dans Totalité et Infini (1961). Dans ce cadre, il apparaît inadéquat de retotaliser l’approche des racismes autour d’une matrice intemporelle, en lissant par avance les rugosités de l’expérience historique.
* Cela hiérarchise implicitement les racismes par rapport à sa matrice supposée, l’antisémitisme, en ne permettant ni de penser de manière plus ouverte les rapports entre l’antisémitisme et les racismes, ni d’envisager des modalités variées de « convergence dans les luttes » des différents antiracismes.
* Par ailleurs, les concepts ne demeurent pas dans le ciel pur des idées, mais interviennent dans des contextes non maîtrisés par les manieurs de concepts. Or, nos concepts et nos paroles en matière de lutte contre l’antisémitisme et de racisme tombent aujourd’hui dans un contexte particulier où les concurrences identitaires et victimaires, dont en particulier la compétition entre luttes contre l’antisémitisme et contre l’islamophobie[1], se sont avivées et où la shoah apparaît en ligne de mire dans des logiques relativistes, voire négationnistes. Poser l’antisémitisme comme « matriciel » quant à tous les racismes dans ce contexte favoriserait ce processus délétère au lieu de le freiner, quelles que soient les bonnes intentions de ses promoteurs. Car, dans une inspiration sociologique et wittgensteinienne, le sens pris par des paroles et des actes dépend largement du contexte dans lequel ils tombent.
Prendre en compte la singularité de l’antisémitisme ne nous oriente pas alors nécessairement vers le chemin « matriciel ». Quelque chose de plus modeste et de plus utile pour nos actions peut se dessiner: par son ancienneté historique, par la forme extrême prise par la logique industrialisée de l’extermination dans la shoah et par la place qu’y joue tout particulièrement la question de l’altérité, l’antisémitisme serait aujourd’hui un des repères cardinaux pour l’analyse des racismes et pour les combats antiracistes. Mais les autres racismes (négrophobie, racisme anti-Arabes islamophobie, racisme anti-Asiatiques, anti-tsiganisme…) ont aussi des singularités. Dans cette perspective, la notion de racisme peut être considérée comme un concept analogique, tel que l’a travaillé en épistémologie sociologique Jean-Claude Passeron[2], c’est-à-dire un cadre comparatif traitant dans un cadre commun des phénomènes pour une part spécifiques, sans les écraser sous une identité a priori, en demeurant attentif à leurs singularités respectives. Et ce cadre analogique a été et est enrichi au cours des luttes antiracistes, dont les luttes contre l’antisémitisme… et d’autres.
Je fais souvent ce rêve étrange et penetrant/D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime/Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même/Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend, écrit Paul Verlaine dans Mon rêve familier (Poèmes saturniens, 1866).
Antisémitisme et racisme ? Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre… Quand Levinas écrit « la même haine de l’autre homme, du même antisémitisme », il demeure d’ailleurs dans une pensée du « même », de l’identité, que sa philosophie met pourtant à distance en inscrivant l’altérité en son cœur. Mais c’est un autre contexte d’énonciation… Plus levinassien que le Levinas le sociologue objectiviste ? Et puis quoi encore, demande le lecteur philosophe, rongeant ses ongles à défaut de ronger son frein !…
Et le RAAR dans tout ça ?
En quoi le RAAR est-il concerné par ce débat ? Dans son nom même l’association indique « contre l’antisémitisme et tous les racismes ». Est-ce que cela signifierait que le « et » constituerait une séparation entre l’antisémitisme et tous les racismes, séparation pouvant alors se connecter à l’hypothèse « matricielle » ?
Pour tenter d’y voir un peu plus clair, il peut être utile de revenir au texte fondateur du Raar, son Manifeste pour un réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes, non pas pour lui donner un caractère d’absolu, mais comme la définition provisoire d’un cadre d’action partagé rendant possible notre maison commune. Or, ce texte indique plusieurs choses :
– Si « l’antisémitisme » est mis à part en regard de « tous les racismes », dans notre nom même, ce n’est pas parce que nous lui donnons une portée « matricielle » par rapport à tous les racismes :
C’est pour réagir à la minoration, dans des secteurs de la gauche, de l’antisémitisme parmi tous les racismes : « Nous notons que beaucoup trop de partisans de l’émancipation sociale et des combats quotidiens contre l’exploitation et les discriminations reproduisent des mécanismes qui les conduisent à minimiser ou à taire les actes et énoncés antisémites. » D’où une modalité importante de l’action du RAAR : « en répertoriant et analysant les formes de banalisation de l’antisémitisme du côté de la gauche et l’extrême gauche, hier comme aujourd’hui ».
Mais le RAAR insère l’antisémitisme dans les racismes : « La lutte contre l’antisémitisme doit faire partie intégrante de l’action contre toutes les formes de racisme. »
– Le RAAR reconnaît la notion d’« islamophobie » (à la différence, par exemple, de la LICRA) et refuse la concurrence entre ces deux formes de racisme : « En participant aux luttes contre tous les autres racismes et en apportant notre solidarité à toutes leurs victimes. Nous refusons notamment l’opposition entre les actions contre l’antisémitisme et celles contre l’islamophobie, le racisme antimusulman ».
Blanchot, Heidegger et les fragilisations intellectuelles de « l’aveuglement extrême »
S’arrêter sur la référence importante à Maurice Blanchot dans la formulation de l’hypothèse de l’antisémitisme comme matrice permet d’aborder autrement la question du contexte et ses effets fragilisants sur le travail de la pensée.
Car Blanchot a une histoire avec…l’antisémitisme et du côté de l’antisémitisme. Dans les années 1930 jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Pétain en juillet 1940, qu’il a approuvé, il a été un écrivain d’extrême droite avec des tonalités antisémites. De 1941 à 1944, il tiendra une chronique littéraire sans positionnement directement politique dans le collaborationniste Journal des débats. On peut interpréter les faits de différentes façons – et des thèses s’opposent radicalement sur cette question – mais des faits sont bien là[3]. Il ne s’agit pas pour moi d’invalider a priori, à cause de son passé, la contribution de Blanchot dans l’après-guerre à la compréhension de l’antisémitisme, mais d’insister, en sociologue, sur les fragilités des conceptualisations en contextes. Or, ce moment antisémite a tendu à être silencié par Blanchot lui-même, qui ne s’est pas clairement expliqué sur ce passé abject. Ce que lui reproche Michel Surya qui écrit :
« Il n’est interdit à personne d’avoir été avant quelqu’un que tout ce qu’on deviendra par la suite conteste, dément, répare, nie… Mais il l’est à la pensée de ne pas le penser. De ne penser aucunement que ce qu’on est devenu s’oppose point par point à ce qu’on a été. Qu’on ne pense pas davantage ce qu’il en coûte de laisser croire le contraire. Et qu’on n’oppose pas davantage aux « révélations » qui en sont parfois faites qu’une défense faible, ou convenue, ou morale » (L’autre Blanchot. L’écriture de jour, l’écriture de nuit, 2015).
Ainsi que le note la figure de l’École de Francfort Theodor Adorno dans son livre Dialectique négative (1966), il y a une exigence autoréflexive de la pensée, tout particulièrement après Auschwitz :
« Si la dialectique négative réclame l’autoréflexion du penser, ceci implique manifestement que, pour être vrai du moins aujourd’hui, ce penser doit aussi penser contre soi-même. S’il ne se mesure pas à ce qu’il y a de plus extérieur et qui échappe au concept, il est par avance du même acabit que la musique d’accompagnement dont la SS aimait à couvrir les cris de ses victimes ».
Un abîme s’ouvre dans le refus de Blanchot de s’interroger de manière publique et critique sur sa contribution intellectuelle à la dynamique menant à l’horreur. Partant, une autre hypothèse, socio-psychologique cette fois, pourrait venir contextualiser, et partant relativiser, sa problématisation dans l’après-guerre de l’antisémitisme comme matrice : et si cette problématisation était nourrie d’une culpabilité vis-à-vis de ce qu’il ne pouvait pas traiter publiquement et qui pourtant le hantait ?
Partant, on pourrait dire à propos de Blanchot des choses analogues à celles que Pierre Bourdieu a écrites sur la façon dont le philosophe Martin Heidegger a silencié dans l’après-guerre son engagement nazi :
« C’est peut-être parce qu’il n’a jamais su ce qu’il disait que Heidegger a pu dire, sans avoir à se le dire vraiment, ce qu’il a dit. Et c’est peut-être pour la même raison qu’il a refusé jusqu’au bout de s’expliquer sur son engagement nazi : le faire vraiment, c’eût été (s’)avouer que la « pensée essentielle » n’avait jamais pensé l’essentiel, c’est-à-dire l’impensé social qui s’exprimait à travers elle, et le fondement vulgairement « anthropologique » de l’aveuglement extrême que seule peut susciter l’illusion de la toute-puissance de la pensée. » (L’ontologie politique de Martin Heidegger, 1988)
Le sociologue souligne le poids que les contextes font peser sur la pensée, même chez ceux qui expriment la plus haute arrogance philosophique, peut-être encore davantage chez eux. Cela ne constitue pas la vérité ultime des singularités Maurice Blanchot et Martin Heidegger, mais cela éclaire les limites de nos conceptualisations et de nos prétentions intellectuellement surplombantes. C’est une leçon d’humilité à méditer.
[1] Voir mon article « Repenser l’universel face aux identitarismes concurrents. Le cas de la compétition entre combats contre l’antisémitisme et contre l’islamophobie dans la France d’aujourd’hui », revue Confluences Méditerranée, n° 121, été 2022.
[2] Jean-Claude Passeron, « L’inflation des diplômes. Remarques sur l’usage de quelques concepts analogiques en sociologie », Revue française de sociologie, vol. 23, n° 4, octobre-décembre 1982.
[3] Pour une présentation synthétique de la controverse, voir Claire Devarrieux, « Maurice Blanchot, trouble je », Libération, 26 avril 2017.