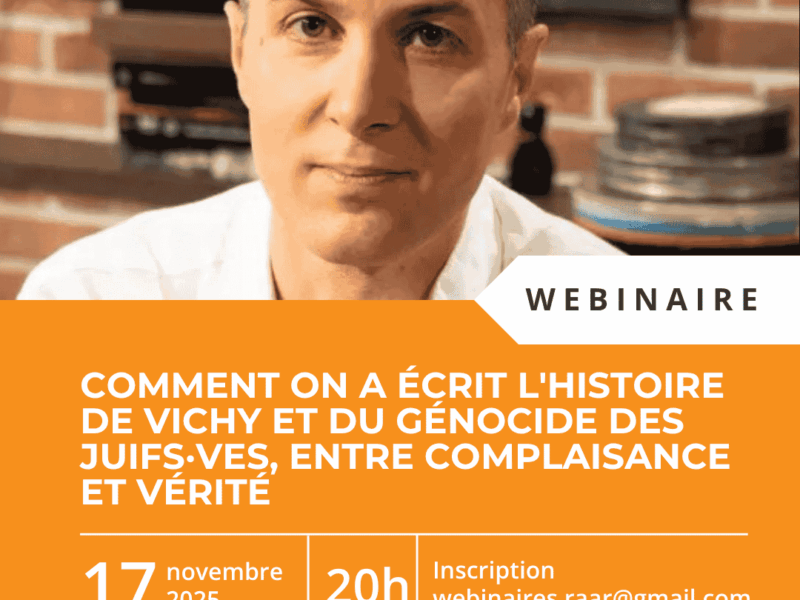De quoi l’UJFP et TSEDEK sont-ils le nom ?
Robert Hirsch, historien
Au printemps 2023, est apparu Tsedek ! (« justice » en Hébreu). Composé de jeunes, ce groupe, très présent sur les réseaux sociaux, peut apparaître sympathique à beaucoup de gens à gauche en raison de son soutien aux Palestinien·nes. Tout comme l’UJFP, créée en 1994, dont est issue une partie des membres de Tsedek. Décrypter le discours de ces deux formations s’avère cependant nécessaire car ils sont porteurs d’une grande nocivité pour la gauche.
Dans un entretien à Frustration du 24 octobre 2023, quelques jours après l’attaque du Hamas, Tsedek! expose ainsi ses objectifs :
« Il nous paraissait urgent de créer une nouvelle maison politique afin de lutter simultanément contre le racisme d’État en France, l’instrumentalisation de l’antisémitisme et contre l’apartheid en Israël-Palestine. »
Dans cet exposé, la lutte contre l’antisémitisme est exclue d’emblée de la lutte anti-raciste. A l’instar de l’UFJP, Tsedek! ne s’intéresse qu’à l’« instrumentalisation », terme cent fois ressassé par ceux qui sont dans le déni de l’antisémitisme. Un déni permis par les théorisations, partagées avec les Indigènes de la République, sur un racisme d’État qui, ne concernant pas les Juif/ves, mettrait ces dernièr·es à l’écart de la lutte antiraciste. Et au-delà de la lutte contre l’instrumentalisation, le combat essentiel pour Tsedek! comme pour l’UJFP est l’antisionisme.
Un antisionisme caricatural
Deux expressions récentes de responsables de l’UJFP sont révélatrices du rapport de ces mouvements au sionisme. Le 19 mars, devant la faculté d’Aix-Marseille, le président de l’UJFP, Pierre Stambul, énonce avec aplomb une analyse stupéfiante :
« Le sionisme a déclaré il y a 120 ans que Juifs et non Juifs ne pouvaient pas vivre ensemble, ni dans le pays d’origine, ni dans l’État juif à construire ».
Ce n’est pas un dérapage. Quelques jours plus tard, la vice-présidente du mouvement, Michèle Sibony, intervient au meeting international des organisations proches de l’UJFP et de Tsedek! en ces termes :
« Le sionisme a choisi la séparation des Juifs du reste du monde ».
Pour l’UJFP, ce sont donc les Juifs qui ont choisi de rejeter le reste du monde à l’initiative du sionisme. Si ce n’était pas tragique, ce serait une énorme plaisanterie : ce n’est pas le reste du monde qui a mis les Juifs à l’écart jusqu’à leur extermination, ce sont les Juifs qui sont les coupables du XXème siècle. On tombe dans une obscène révision de l’histoire pour les besoins de l’antisionisme. En falsifiant ainsi le sionisme, on ne peut avoir qu’une lecture fallacieuse de l’antisionisme.
Les jeunes de Tsedek! ne sont pas plus perspicaces que leurs aînés, expliquant dans leur manifeste :
« L’État d’Israël est une émanation du colonialisme européen et doit son existence à la dépossession des Palestinien·ne·s et à la négation de leurs droits – Ni « conflit religieux », ni « lutte civilisationnelle », mais une situation coloniale en Israël/Palestine. »
Pour ce collectif, le sionisme n’est qu’un colonialisme, par ailleurs raciste, l’État d’Israël étant défini comme « suprémaciste et colonial ». Jamais dans leurs textes n’est évoquée une dimension essentielle de la naissance de l’État d’Israël pour la plupart des Juif·ves, qu’ils et elles soient ou non sionistes, à savoir la création d’un refuge face aux drames du siècle passé et d’une persécution plurimillénaire.
C’est à l’aune de cet antisionisme que le mouvement a jugé les événements du 7 octobre, considérant, le 9, que « les murs barbelés de cette prison (Gaza] ont été franchis. » L’attaque sanglante du Hamas est considérée comme une « offensive de la résistance palestinienne ».
Dès le 17 octobre, évoquant les 2808 Palestinien.nes alors tué.es à Gaza, les militant.es de Tsedek! parlent de « génocide », reprenant ainsi la terminologie d’une partie de la gauche qui, depuis des années, ne cesse de faire des comparaisons absurdes entre Israël et le nazisme. Cet amalgame constitue une dérive essentielle de l’antisionisme. Elle le relie à des milieux soulagés de pouvoir ainsi exprimer un antisémitisme refoulé depuis 1945.
Tsedek! reconnaît le caractère « brutal » de l’action du Hamas le 7 octobre, mais parle de « crimes de guerre » commis par des « combattants palestiniens ». Dans son blog du 13 octobre, quelques jours seulement après les crimes que l’on sait, le collectif se range au point de vue répété ad nauseam dans la gauche radicale :
« Les références à l’antisémitisme génocidaire nazi ou au terrorisme islamiste d’Al-Qaeda ou de l’État islamique sont inopérantes dans un contexte de lutte de libération nationale contre un État colonial et relèvent de l’instrumentalisation idéologique de l’histoire. »
C’est au contraire Tsedek! qui se livre à une instrumentalisation idéologique de l’histoire lorsqu’ils nient sans démonstration aucune l’antisémitisme du plus grand massacre de Juif/ves depuis la Seconde Guerre mondiale. Un massacre qui fait écho aux catastrophes du passé, et bien sûr à la Shoah. C’est là un déni de la réalité et de l’éducation des membres du Hamas, biberonnés à l’antisémitisme, notamment par la charte de 1988 du mouvement, inspirée des Protocoles des sages de Sion. Nourris de ces références, ils pénètrent dans un kibboutz pour massacrer le plus de Juif/ves qu’ils rencontrent. Et l’antisémitisme y serait étranger ?
La négation de ce que fut le 7 octobre illustre parfaitement le rapport de ces mouvements à l’antisémitisme.
Le déni de l’antisémitisme
Il est ancien à l’UJFP, qui a décidé de regarder ailleurs lors de la vague antisémite du début des années 2000. En 2006, l’année de l’assassinat d’Ilan Halimi, dans la revue de ce groupe, De l’Autre Côté, le philosophe Alain Brossat parlait d’« antisémitisme largement de synthèse », fabriqué par les soutiens de l’État d’Israël. Alors que, depuis six ans, se multipliaient les actes antisémites, jusque dans les écoles et collèges.
Tout au long de ces années, rythmées pour les Juif/ves par le retour de la haine, l’UJFP n’a cessé de relativiser la gravité de l’antisémitisme, refusant par exemple de manifester après l’assassinat d’Ilan Halimi en 2006. Lorsque le pire arriva, en 2012, à l’école Ozar Hatorah de Toulouse, l’UJFP se montra inquiète… pour les musulman.es de France, qui auraient pu en subir les conséquences. Certes. Mais, ce ne fut pas le cas, et, surtout, l’UJFP ne s’intéressa nullement à l’angoisse des Juif/ves, encore une fois pris pour cibles. Le communiqué du mouvement se conclut ainsi :
« La politique criminelle pratiquée par Israël à l’encontre du peuple palestinien tout entier, au mépris du droit international, met en danger la paix et la cohésion de toutes les sociétés, de la nôtre en particulier [1]».
C’était donner à l’État d’Israël un rôle mondial disproportionné, qui rappelle… Les Protocoles des Sages de Sion.
Le déni de l’antisémitisme par l’UJFP recoupe la théorie du « philosémitisme d’Etat » des Indigènes de la République, selon lesquels les Juifs seraient aujourd’hui protégés par les classes dominantes. L’UJFP, qui collabore régulièrement avec Houria Bouteldja et a promotionné son livre, Les Blancs, les Juifs et nous (2016), a repris la théorisation des Indigènes dans une brochure publiée en 2016 et destinée à la jeunesse. Voilà comment cet opuscule parle des Juif/ves :
« Ils sont aujourd’hui utilisés comme fers de lance des discriminations à l’encontre d’autres groupes humains, et plus particulièrement des musulmans [2]».
Ce n’est pas là qu’une formule malheureuse ; quelques pages plus loin, on trouve :
« Les uns – les Juifs – risquent de devenir des acteurs-clés du racisme à l’encontre des autres – les musulmans »[3].
L’UJFP explique donc aux jeunes que les Juifs sont les premiers responsables du racisme que subissent certains d’entre eux. Quelle irresponsabilité !
Tsedek! reprend cette vision. Pour eux, l’État est responsable de l’antisémitisme, notamment par «son rapport identitaire à la laïcité », reprenant ainsi la terminologie des ennemis de la laïcité. Il conviendrait donc, pour les militant.es de Tsedek!, de « dépasser l’instrumentalisation de l’antisémitisme », qui serait selon eux un« outil de gouvernance autoritaire qui cible en particulier les musulman·es, la gauche, et les organisations des droits humains ». On voit bien comment cette théorie divise les antiracistes.
C’est la reprise des thèses des Indigènes et des courants qui considèrent, depuis des années, que l’islamophobie a remplacé l’antisémitisme. Il n’y aurait donc plus à s’inquiéter de la haine antijuive. Tsedek! va d’ailleurs plus loin que l’UJFP, faisant organisation commune avec Bouteldja dans le « QG Décolonial » et participant au média indigéniste « Paroles d’honneur ». Ils ne disent rien sur l’antisémitisme réel, qui menace aujourd’hui les Juif/ves et en a déjà tué certain.es depuis une vingtaine d’années. Cet antisémitisme, souvent issu de milieux eux-mêmes victimes du racisme, est occulté. Tsedek reconnaît une montée des actes antisémites après le 7 octobre, mais en rend responsables Israël et le gouvernement français, notamment ce dernier à cause des interdictions de manifestations en faveur des Palestinien·nes[4].
Cette volonté de l’UJFP et de Tsedek de relativiser ou de nier l’antisémitisme actuel renvoie à leur souci de demeurer connectés à la gauche la plus radicale, avec laquelle ces mouvements agissent. Cette logique a des conséquences sur leur appréciation de la Shoah.
Et la Shoah ?
L’affirmation selon laquelle le sionisme aurait « choisi la séparation des Juifs du reste du monde », selon la formule de Michèle Sibony, occulte la violence du XXème siècle antisémite, qui culmina dans l’extermination nazie. Or, celle-ci est désormais banalisée, la même Sibony, citant un poète israélien disparu, s’exprimant ainsi au début de son intervention au meeting du 30 mars dernier :
« La shoah des Juifs européens et la shoah des Arabes de Palestine, sont une seule et même shoah pour le peuple juif ».
Qu’est-ce que la « shoah des Arabes », on ne le saura pas. Mais, cette formulation relativise ce que le nazisme fit subir aux Juif/ves.
Le colloque organisé les 25 et 26 janvier 2025 par l’UJFP et Tsedek! en est une illustration. Le 80ème anniversaire de la découverte/libération d’Auschwitz fut l’occasion d’une comparaison avec la dramatique situation de Gaza. Rony Brauman alla même jusqu’à expliquer que l’horreur de Gaza dépassait celle d’Auschwitz, dont la mémoire apparaissait comme « un crachat à la face des Palestiniens ». Ce qui a donné lieu à une protestation de 140 personnes, défendant « la mémoire d’Auschwitz pour les combats d’aujourd’hui »[https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/defendre-la-memoire-dauschwitz-pour-les-combats-daujourdhui-20250219_3OMODWG27RDO3DCCDKLHZWRGAE/]. En effet, l’UJFP et Tsedek! participent d’une offensive idéologique qui vise à relativiser le rôle de la Shoah dans la conscience du monde et dans la construction d’un front solidaire antiraciste et antifasciste, qu’ils contribuent à diviser. C’est d’une extrême gravité à l’heure où soufflent les vents mauvais de l’extrême droite.
Cette pensée, qui considère que les Juif/ves font partie des dominants et que cette situation est renforcée par leur soutien à Israël, n’a rien à faire à gauche. La logique ultime de ce nouveau courant c’est la banalisation de la Shoah et de sa mémoire. C’est-à-dire la remise en cause de l’antifascisme. Non, décidément, l’UJFP et Tsedek! ne sont pas des organisations alliées, elles sont la caution juive du déni de l’antisémitisme. Dans sa visée émancipatrice, la gauche doit entendre ces discours de division pour ce qu’ils sont, les mettre à l’écart et porter un message fort de rassemblement dans la lutte antiraciste.
[1] Site internet de l’UJFP, 25 mars 2012.
[2] UNION JUIVE FRANÇAISE POUR LA PAIX, Une parole juive contre le racisme, p. 60.
[3] UNION JUIVE FRANÇAISE POUR LA PAIX, Une parole juive contre le racisme, p. 67.
[4] Billet de blog dans Mediapart du 4 novembre 2023
: