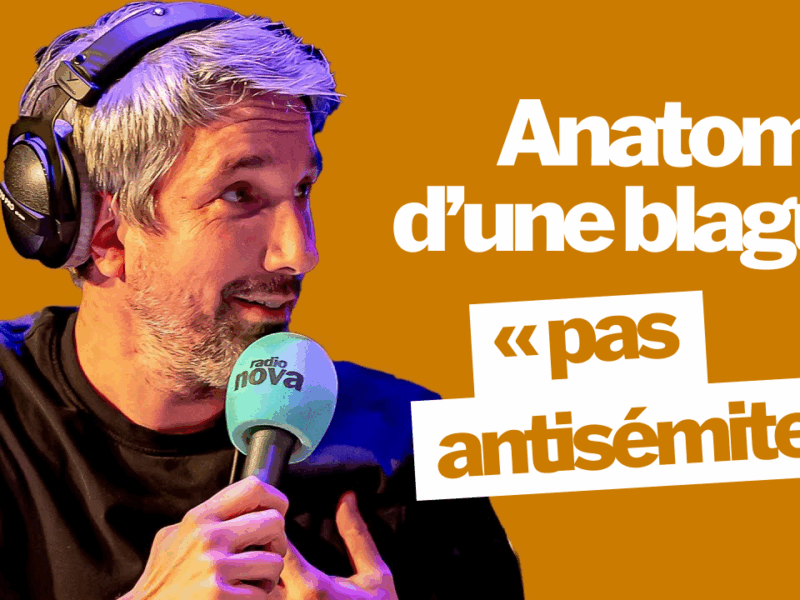L’ « entrisme islamiste », dernier avatar du confusionnisme
Philippe Marlière, Professeur de sciences politiques à University College, London
Le Nouvel Obs, 5 mai 2025
Avec cette expression qui réfère à l’histoire de la gauche, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau crée une menace floue et infondée. Bonne vieille stratégie inaugurée par Nicolas Sarkoy.
Le 24 avril, Bruno Retailleau a présenté le lycée musulman Averroès à Lille comme un « bastion de l’entrisme islamiste ». La veille, le tribunal administratif avait rétabli le contrat d’association avec l’Etat, résilié par la préfecture du Nord en décembre 2023 pour « manquements graves aux principes fondamentaux de la République ». Dans son jugement détaillé de 19 pages, le tribunal administratif de Lille a estimé que « l’existence de manquements graves au droit » n’était pas établie et relevé que la procédure d’annulation était « entachée d’irrégularités ».
Une stratégie amorale qui banalise le RN
Au lendemain du meurtre d’un musulman dans la mosquée de La Grand-Combe (Gard), Retailleau a récusé le terme d’« islamophobie » utilisé par le Premier ministre François Bayrou et réitéré ses propos sur l’« entrisme islamiste ». Il a annoncé la publication imminente d’un rapport « accablant » sur l’influence des Frères musulmans dans la société française. Dans un entretien au « Figaro », le ministre de l’Intérieur a affirmé que les fréristes pourraient infiltrer les listes électorales lors des prochaines élections municipales de 2026 : « On parvient à contenir l’entrisme, mais l’année prochaine, il risque d’y avoir des entrées dans les listes municipales avec ce discours : “Si vous nous prenez, nous apporterons un paquet de voix”. »
L’accusation d’entrisme islamiste n’est pas nouvelle. Il y a un an, Gabriel Attal, alors Premier ministre, avait dénoncé sur BFMTV un « entrisme islamiste qui prône les préceptes de la charia, notamment dans les écoles ». En mars, Elisabeth Borne, ministre de l’Education nationale, a estimé dans un entretien au « Parisien » qu’il fallait « lutter contre la progression de l’entrisme dans la société » en interdisant le port des signes religieux dans le sport. A l’accusation de « séparatisme islamiste » (qui avait abouti à la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République) a succédé celle d’« entrisme ». En l’espace de quatre ans, on a successivement reproché aux islamistes (ou musulmans ?) de créer des contre-sociétés et de faire sécession, puis d’infiltrer les institutions scolaires et politiques du pays. Ces accusations sont contradictoires et incohérentes, ce qui démontre leur caractère fantaisiste.
« Islamo-gauchisme », « séparatisme », « wokisme », « entrisme » : les accusations brumeuses et péremptoires se succèdent à l’encontre des musulmans et de la gauche désignée comme complice de l’islamisme. Elles sont cependant vite abandonnées, car elles ne reposent sur rien d’autres que des amalgames et des exagérations qui cherchent à mettre en difficulté la gauche et flatter les électeurs du Rassemblement national (RN). Cette stratégie amorale ne fait que banaliser les idées du RN et renforcer l’extrême droite.
Un emprunt à l’histoire de la gauche révolutionnaire
Le choix du terme « entrisme » n’est pas anodin. Il appartient au registre de la gauche révolutionnaire. En juin 1934, Léon Trotski invite ses partisans réunis dans la Ligue communiste à adhérer à la SFIO. Une alliance des gauches communiste, socialiste et radicale est en gestation pour contrer l’offensive des ligues fascistes en France et en Europe. Celle-ci aboutira à la formation d’un Front populaire qui remportera l’élection législative de 1936.
Trotski opère une rupture stratégique importante appelée « tournant français ». Exclus des partis communistes staliniens, les trotskistes vont rejoindre les formations sociales-démocrates pour y militer et animer des courants révolutionnaires. En France, les trotskistes de la SFIO forment le Groupe bolchevik-léniniste. Cette stratégie est connue sous le vocable d’« entrisme ».
L’entrisme est une stratégie politique qui voit des militants révolutionnaires adhérer collectivement à une formation de gauche réformiste. L’objectif de cette infiltration – qui peut être officielle (« à drapeaux déployés » disait Trotski), mais est plus souvent clandestine – est d’infléchir la ligne du parti social-démocrate et de radicaliser ses membres.
L’entrisme, comme stratégie de court terme, se déploie quand la conjoncture est défavorable aux forces révolutionnaires : le 6 février 1934, la marche des ligues fascistes à Paris déstabilise la IIIe République et le stalinisme, dominant à gauche, isole les trotskistes. Après la Seconde Guerre mondiale, Michel Pablo, l’un des dirigeants de la IVe Internationale (trotskiste), esquisse une stratégie entriste de longue durée pour éviter aux cercles révolutionnaires de s’isoler des masses ouvrières acquises à la social-démocratie.
Lionel Jospin est l’exemple le plus célèbre d’entrisme sur la longue durée. Membre de l’Organisation communiste internationaliste (OCI), il rejoint clandestinement le PS, en gravit les échelons pour en devenir le premier secrétaire en 1981. La tendance Démocratie et Révolution, animée par Gérard Filoche au sein de la Ligue communiste révolutionnaire, rejoint le PS en 1994, « à drapeaux déployés », et y est active jusqu’en 2017. Ni Jospin, rallié à la social-démocratie, ni Filoche, neutralisé par les réformistes de l’aile gauche socialiste (par Jean-Luc Mélenchon notamment), n’auront pu ou voulu réorienter le PS dans une direction révolutionnaire.
Créer des ennemis imaginaires
Les propos de Retailleau s’inscrivent dans un mouvement réactionnaire international de captation des références et symboles de la gauche. Ce phénomène n’est pas récent. Dès 2007, Nicolas Sarkozy revendiquait un « gramscisme culturel », estimant que le « pouvoir se gagne par les idées » et qu’il « assum[ait] cette bataille-là ». Reprenant l’expression de « guerre de position » (opposée à la « guerre de mouvement », c’est-à-dire l’insurrection), Sarkozy, conseillé par le journaliste d’extrême droite Patrick Buisson, préconisait la mise en œuvre de « guerres culturelles » contre la « pensée conformiste » de gauche et de droite. L’ex-président a ainsi contribué à affaiblir le clivage gauche/droite et à nourrir le confusionnisme que Philippe Corcuff décrit comme le « nom actuel d’une désagrégation relative des repères politiques antérieurement stabilisés autour du clivage gauche/droite et du développement de passerelles discursives entre extrême droite, droite et gauche radicale. Confusionnisme, au sens retenu ici, n’est donc pas synonyme de “confusion”, mais revêt un sens politico-idéologique précis. La trame confusionniste a pour principal effet, dans le contexte politico-idéologique actuel, de faciliter l’extension de postures et de thèmes venant de l’extrême droite ».
L’« islamo-gauchisme » était inspiré par le « judéo-bolchévisme », terme indiquant que les partis communistes étaient contrôlés par les juifs, dont le dessein secret était la domination mondiale. Le « séparatisme islamiste » a les relents de « parti de l’étranger » de l’appel de Cochin. En 1978, Jacques Chirac avait fustigé le fédéralisme européen de l’UDF, parti du président Giscard d’Estaing. Le « wokisme » est un détournement de « woke », argot afro-américain, qui invite à prendre conscience des injustices sociales contre les groupes dominés et à se mobiliser contre elles. « L’entrisme islamiste » est une incursion plus nette et intime dans l’histoire de la gauche révolutionnaire.
Dans tous les cas précités, on détourne le sens premier d’un terme historique, au besoin en popularisant un néologisme, qu’on utilise comme formule-choc contre ses adversaires politiques. Ces vocables n’ont aucunement l’intention d’expliquer le monde tel qu’il est, mais de créer des ennemis imaginaires pour cliver, susciter la peur et incarner un « bon sens » anti-élites. Ce faisant, la droite continue la besogne confusionniste entreprise par Sakozy pour le grand bénéfice de l’extrême droite.